11/02/2021
Un vieil article inédit sur Thomas Bernhard
Ce 9 février, le grand écrivain autrichien Thomas Bernhard, aurait eu 90 ans, s'il n'était mort prématurément il y a déjà trente-deux ans. C'est un écrivain qui a beaucoup compté pour moi. J'ai gardé tous ses livres dans ma bibliothèque, j'en relis certains de temps à autre. En 1988, alors que Bernhard était en pleine créativité, j'avais consacré un article à son roman Maîtres anciens, qui venait de paraître en France. Cette recension était destinée à une nouvelle revue, créée par de jeunes diplômés aux ambitions européennes. Ils étaient très gentils, mais je me demandais quand même ce que je faisais parmi eux. Je pris le premier prétexte venu pour partir, et, donc, mon article ne parut jamais. Je me rappelle aussi l'avoir fait lire à l'historien monarchiste Éric Vatré, avec qui alors je déjeunais quelquefois sur l'île Saint-Louis. Vatré avait apprécié le texte, mais moins les explications que je lui donnais sur les révoltes intimes de Thomas Bernhard. De là date ma brouille tacite avec lui. Chaque lecture d'un roman de Bernhard évoque pour moi tout un pan de ma vie. Cet auteur m'a construit, et je dois dire qu'aujourd'hui je m'en félicite toujours autant. Voici donc ce petit article sans prétention sur Maîtres anciens, "Comédie", que j'exhume d'une chemise portant la date suivante : 30-9-1988. Le titre en était "Un artiste de la survie", et il s'ouvrait sur une phrase de Wittgenstein : "Parfois on pense, parce que cela a fait ses preuves."
Le nouveau livre de Thomas Bernhard, avec Peter Handke l'un des écrivains autrichiens – et même européens ! – les plus réputés, porte en sous-titre : "Comédie", et nous constatons en effet que dans ce livre, comme dans les précédents (qui ont eu une si grande influence sur nous), Bernhard ne parle que de la comédie de la vie, de ses aspects burlesques et comiques, mais tragiquement burlesques et tragiquement comiques. Ce moraliste d'aujourd'hui ne nous épargne aucune vérité, ni sur l'État, ni sur l'Autriche, ou bien encore l'éducation, et même Heidegger ("ce ridicule petit-bourgeois national-socialiste en culotte de golf") par Reger interposé.
Reger, personnage central du livre, Autrichien critique musical au Times, se définit lui-même comme un véritable détestateur du monde : rien ne résiste à son dénigrement universel, particulièrement violent : "Mais même Mozart, dit Reger, n'a pas échappé au kitsch, surtout dans les opéras il y a tant de kitsch, dans la musique de ces opéras superficiels la taquinerie et l'affairement se bousculent souvent aussi, de manière insupportable." Reger en un long soliloque (c'est aussi un artiste de la parole) enfonce le clou sans se lasser. Il énonce ceci : "notre vie est intéressante dans l'exacte mesure où nous avons pu développer notre art de la parole comme notre art du silence".
En contrepoint, dans le cours (musical) de ce soliloque mouvant mais admirablement composé par Bernhard, Reger déploie un point de vue parallèle – le silence – qui, s'il part encore de l'art, rejoint néanmoins la vie en plein. L'art pour l'art est banal, relégué, chez Reger, spécialiste de l'art. Sa femme venait de mourir. Pour surmonter cette épreuve, il a l'idée de recourir encore une fois à l'art. Mais l'art est impuissant. Reger dit : "tout l'art, quel qu'il soit, n'est rien comparé à ce seul et unique être aimé" qu'il vient de perdre. Cette révélation modifie considérablement sa philosophie de l'art. Il retournera à l'art en l'utilisant comme moyen de survie, "art de survie", dit-il. Et c'est tout. Il semble avoir cerné les limites de l'art (de la vie), à force de philosophie, et n'attend plus que la mort, tranquillement (il a quatre-vingt-deux ans).
Reger est, pendant tout le livre, assis devant L'homme à la barbe blanche de Tintoret : c'est lui-même qu'il contemple, ce faisant, sa vieillesse, son désespoir et sa solitude.
Art de la survie, a dit Reger pour avoir éprouvé cette vérité jusqu'au désespoir. Un art précis, enfin utilisable, intelligent dans son imperfection même, l'imperfection de l'art (toujours selon Reger) est la condition sine qua non de sa précision admirable. Cela nous sauve. Selon ce que dit encore Reger, survivre est la grande affaire. Après la mort de sa femme il ne s'est pas suicidé : "Si nous ne nous suicidons pas tout de suite, nous ne nous suicidons pas, c'est cela qui est affreux, a-t-il dit." Il constate que c'est Schopenhauer qui l'a sauvé, non pas la peinture, ni la musique. Il s'est esquivé dans Schopenhauer, pour fuir la vie synonyme de malheur : ainsi supporte-t-il cette vie même, car par Schopenhauer il ne fait rien d'autre que de renouer avec cette vie qu'il voulait abandonner.
Ce raisonnement semble être l'aboutissement d'une spéculation sur le suicide, que Thomas Bernhard avait engagée depuis longtemps, et à laquelle il apporte maintenant cette réponse acceptable, c'est-à-dire une réponse dénuée, si possible, d'hypocrisie et d'idéalisme stupide, car même lorsqu'il affirme la supériorité de la vie (ou de l'amour), il reste un nihiliste. Bernhard nous dit que la vie peut être une expérience merveilleuse, mais pas à n'importe quel prix ! Fondamentalement pessimiste (antihumaniste comme Pascal, son maître), Bernhard pense cependant, malgré tout, que la vie mérite d'être vécue, mais pas n'importe comment ! Être vigilant !...
La lecture de Maîtres anciens est évidemment une fête pour l'esprit. On doit ressentir cette voix qui nous parle directement à l'oreille, c'est une voix proche, vivante, simple, d'où naît une sensation de réalité. Le frémissement de la vie passe de façon prodigieuse, grâce à ce procédé des monologues qui tissent ce livre. Les personnages, nous les voyons. Rien de préfabriqué, ici. Les personnages sont simplement disposés sur l'échiquier théâtral (le Musée d'art ancien de la ville de Vienne). Ils sont immobiles. Et ils parlent, surtout Reger qui a dit aussi : "Ce que je pense est exténuant, destructeur, a-t-il dit, d'autre part cela m'exténue déjà depuis si longtemps que je n'ai plus besoin d'avoir peur."
Thomas Bernhard, Maîtres anciens. Comédie. Traduit de l'allemand (Autriche) par Gilberte Lambrichs. Éd. Gallimard, 1988. Disponible dans la coll. "Folio", 8,60 €. Prix Médicis étranger 1988. – À noter, la publication récente (fin janvier 2021) d'un remarquable Cahier de L'Herne consacré à Thomas Bernard (33 €), dont j'ai rendu compte dans un article paru sur le site Causeur.
07:42 Publié dans Livre | Tags : thomas bernhard, maîtres anciens, wittgenstein, heidegger, musique, art, survie, schopenhauer, le tintoret, cahiers de l'herne | Lien permanent | Commentaires (0)
26/06/2018
Nécessité de Kierkegaard
L'entrée de Kierkegaard (1813-1855) dans la collection de la Pléiade est un événement fort de la vie intellectuelle. Il en est ainsi, d'abord parce qu'il s'agit de traductions nouvelles, pour un choix d'œuvres qui couvrent toute la vie du philosophe. Ensuite, parce que, comme souvent dans la Pléiade, l'édition est excellente (préface, notices et notes) ; on la doit à un grand spécialiste de la littérature scandinave, Régis Boyer, qui y a travaillé jusqu'à sa mort. Il est faux de dire par exemple que les lecteurs ne lisent, dans une Pléiade, que la préface, et que son seul intérêt serait bibliophilique. Une Pléiade comme celle-ci se déguste au contraire in extenso, et pour avoir les deux volumes de Kierkegaard entre les mains, je peux assurer que le jeu en vaut la chandelle. S'il faut partir cet été avec deux livres en vacances, ce seront ceux-ci.
On connaît grosso modo la pensée de Kierkegaard, son existence dans le petit Danemark, sa silhouette de dandy, et surtout son influence considérable sur la littérature et la philosophie du XXe siècle. Le père de l'existentialisme sartrien, c'est lui, sans parler de tout ce qu'ont pu y puiser un Heidegger, un Wittgenstein, et, bien sûr, un Kafka. "Car Kierkegaard ne cesse de provoquer et d'inspirer, prévient Régis Boyer. La diffusion de cette œuvre dans le monde est impressionnante et continue de surprendre." À en relire aujourd'hui les grandes étapes, on se dit qu'elle a toujours quelque chose de neuf et d'essentiel à nous dire.
Un des grands attraits de Kierkegaard est, me semble-t-il, qu'il n'est pas titulaire d'un genre précis. Ses études de théologie, dans sa jeunesse, l'ont amené à sortir des sentiers battus de la philosophie et à s'intéresser aux questions universelles. Régis Boyer écrit ainsi, pour tenter de le définir : "on le croit philosophe, il se dit non philosophe, auteur religieux plutôt ou même poète du religieux. Toujours, en tout cas, à la limite de la philosophie et de ce qui n'est pas elle."
La grande découverte de Kierkegaard, qui en fait un auteur tellement aimé, réside dans le fait d'avoir donné "la préséance à la subjectivité saisie en son sens le plus radical". Après l'époque précédente des systèmes philosophiques clos sur eux-mêmes, comme chez Hegel, ce retour vers le sujet humain était une sorte de respiration grandiose dans la pensée. Kierkegaard pouvait ainsi asséner sa conviction première : "Seule, la vérité qui édifie est vérité pour soi." On imagine tout ce qu'une telle conviction put entraîner comme conséquences fortes, notamment à propos de la grande question de la liberté qui habite ou non l'homme. Pour Kierkegaard, à chaque fois que l'homme décide d'une chose, dans un déferlement de contingence infinie, il opère comme un saut dans le vide. Ce n'est pas sans raison que Kierkegaard sera, avant tout, le penseur de l'angoisse existentielle. "L'angoisse est le vertige de la liberté", dira-t-il dans Le Concept d'angoisse.
Ces deux volumes de la Bibliothèque de la Pléiade permettent un parcours passionnant dans l'œuvre du Danois (il y manque seulement, faute de place, un jalon pourtant important, le Post-scriptum aux miettes philosophiques de 1846). Les différents registres de l'écrivain sont présents, de Ou bien... Ou bien, en passant par La Reprise, jusqu'à des écrits plus proprement religieux et qu'on lisait moins. C'était dommage, car on y retrouve le style unique et subversif du dernier Kierkegaard, le pamphlétaire qui ferrailla durement avec l'Église de son temps jusqu'à s'en exclure irrémédiablement. Pour avoir voulu, à la fin de sa courte vie, "rétablir le christianisme dans la chrétienté", ainsi qu'il l'exprimait lui-même dans une formule volontairement provocatrice, Kierkegaard est mort dans la solitude et le quasi-dénuement. Tel est souvent le prix de la probité et du génie.
Kierkegaard, Œuvres, tomes I & II. Textes traduits, présentés et annotés par Régis Boyer, avec la collaboration de Michel Forget. Éd. Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 62 & 63 €.
15:17 Publié dans Livre | Tags : kierkegaard, bibliothèque de la pléiade, régis boyer, dandy, littérature, philosophie, heidegger, wittgenstein, kafka, sartre, existentialisme, subjectivité, angoisse, christianisme, théologie | Lien permanent | Commentaires (1)
05/02/2014
Philosopher
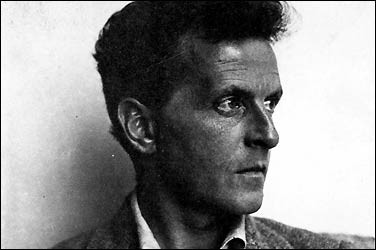
La philosophie est à mon sens un art du discours. Lorsqu'on critique la rhétorique, comme Platon dans le Gorgias, on n'en utilise pas moins une pensée discursive. L'antirhétorique est elle-même une rhétorique, certes d'un niveau fort supérieur. Les grands philosophes m'ont toujours semblé écrire dans une langue très belle, très littéraire. C'est au fond une langue qu'il faut apprendre, et s'approprier, si l'on veut comprendre comment s'agence le discours philosophique. La pensée moderne, plus qu'une autre, consiste dans cet art de dire : non pour prouver quoi que ce soit, peut-être, mais pour déployer un raisonnement au terme duquel aucune vérité n'émergera. La seule vérité, ou les vérités, plutôt, se trouvent potentiellement dans l'espace du discours. Il a fallu des siècles pour pressentir cette richesse dans l'immobilité de la pensée, même si la dette envers les auteurs anciens doit être constamment reconnue. Cette immobilité était déjà en germe chez Epicure (qui n'a pas voulu faire œuvre, comme on sait) et combien d'autres. Quand j'avais lu par exemple les Leçons sur la liberté de la volonté de Wittgenstein, j'avais constaté avec délectation que Wittgenstein ne proposait aucune doctrine sur le libre arbitre. Dans ses leçons, tout simplement, le but n'était pas de conclure. Voilà en fait ce qu'il fallait comprendre !
17:59 Publié dans Philosophie | Tags : philosophie, art du discours, platon, gorgias, rhétorique, littéraire, pensée moderne, vérité, immobilité, épicure, wittgenstein, leçons sur la liberté de la volonté, ne pas conclure | Lien permanent | Commentaires (0)
