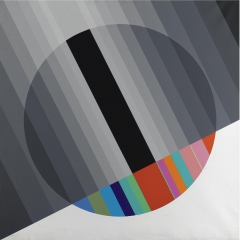26/06/2018
Nécessité de Kierkegaard
L'entrée de Kierkegaard (1813-1855) dans la collection de la Pléiade est un événement fort de la vie intellectuelle. Il en est ainsi, d'abord parce qu'il s'agit de traductions nouvelles, pour un choix d'œuvres qui couvrent toute la vie du philosophe. Ensuite, parce que, comme souvent dans la Pléiade, l'édition est excellente (préface, notices et notes) ; on la doit à un grand spécialiste de la littérature scandinave, Régis Boyer, qui y a travaillé jusqu'à sa mort. Il est faux de dire par exemple que les lecteurs ne lisent, dans une Pléiade, que la préface, et que son seul intérêt serait bibliophilique. Une Pléiade comme celle-ci se déguste au contraire in extenso, et pour avoir les deux volumes de Kierkegaard entre les mains, je peux assurer que le jeu en vaut la chandelle. S'il faut partir cet été avec deux livres en vacances, ce seront ceux-ci.
On connaît grosso modo la pensée de Kierkegaard, son existence dans le petit Danemark, sa silhouette de dandy, et surtout son influence considérable sur la littérature et la philosophie du XXe siècle. Le père de l'existentialisme sartrien, c'est lui, sans parler de tout ce qu'ont pu y puiser un Heidegger, un Wittgenstein, et, bien sûr, un Kafka. "Car Kierkegaard ne cesse de provoquer et d'inspirer, prévient Régis Boyer. La diffusion de cette œuvre dans le monde est impressionnante et continue de surprendre." À en relire aujourd'hui les grandes étapes, on se dit qu'elle a toujours quelque chose de neuf et d'essentiel à nous dire.
Un des grands attraits de Kierkegaard est, me semble-t-il, qu'il n'est pas titulaire d'un genre précis. Ses études de théologie, dans sa jeunesse, l'ont amené à sortir des sentiers battus de la philosophie et à s'intéresser aux questions universelles. Régis Boyer écrit ainsi, pour tenter de le définir : "on le croit philosophe, il se dit non philosophe, auteur religieux plutôt ou même poète du religieux. Toujours, en tout cas, à la limite de la philosophie et de ce qui n'est pas elle."
La grande découverte de Kierkegaard, qui en fait un auteur tellement aimé, réside dans le fait d'avoir donné "la préséance à la subjectivité saisie en son sens le plus radical". Après l'époque précédente des systèmes philosophiques clos sur eux-mêmes, comme chez Hegel, ce retour vers le sujet humain était une sorte de respiration grandiose dans la pensée. Kierkegaard pouvait ainsi asséner sa conviction première : "Seule, la vérité qui édifie est vérité pour soi." On imagine tout ce qu'une telle conviction put entraîner comme conséquences fortes, notamment à propos de la grande question de la liberté qui habite ou non l'homme. Pour Kierkegaard, à chaque fois que l'homme décide d'une chose, dans un déferlement de contingence infinie, il opère comme un saut dans le vide. Ce n'est pas sans raison que Kierkegaard sera, avant tout, le penseur de l'angoisse existentielle. "L'angoisse est le vertige de la liberté", dira-t-il dans Le Concept d'angoisse.
Ces deux volumes de la Bibliothèque de la Pléiade permettent un parcours passionnant dans l'œuvre du Danois (il y manque seulement, faute de place, un jalon pourtant important, le Post-scriptum aux miettes philosophiques de 1846). Les différents registres de l'écrivain sont présents, de Ou bien... Ou bien, en passant par La Reprise, jusqu'à des écrits plus proprement religieux et qu'on lisait moins. C'était dommage, car on y retrouve le style unique et subversif du dernier Kierkegaard, le pamphlétaire qui ferrailla durement avec l'Église de son temps jusqu'à s'en exclure irrémédiablement. Pour avoir voulu, à la fin de sa courte vie, "rétablir le christianisme dans la chrétienté", ainsi qu'il l'exprimait lui-même dans une formule volontairement provocatrice, Kierkegaard est mort dans la solitude et le quasi-dénuement. Tel est souvent le prix de la probité et du génie.
Kierkegaard, Œuvres, tomes I & II. Textes traduits, présentés et annotés par Régis Boyer, avec la collaboration de Michel Forget. Éd. Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 62 & 63 €.
15:17 Publié dans Livre | Tags : kierkegaard, bibliothèque de la pléiade, régis boyer, dandy, littérature, philosophie, heidegger, wittgenstein, kafka, sartre, existentialisme, subjectivité, angoisse, christianisme, théologie | Lien permanent | Commentaires (1)
22/08/2017
Saint Augustin en Bouquins
Il y a des lectures qui demandent du temps. Je vous dis aujourd'hui quelques mots des Sermons sur l'Écriture de saint Augustin, publiés en 2014, parce que je viens juste de les terminer. La collection "Bouquins" de chez Laffont avait eu l'heureuse idée de les republier alors, sous la houlette de Maxence Caron, et dans une traduction du XIXe siècle. C'est ainsi 1500 pages de texte qui étaient proposées au public du XXIe siècle. Dans sa préface, Maxence Caron partait d'un constat pessimiste : "Notre époque est la première depuis saint Augustin à ne pas avoir accès aux Sermons de saint Augustin. Leur dernière publication remonte à cent cinquante années. C'était au XIXe siècle. Le XXe siècle français ne les publia donc pas." Maxence Caron écrivait cela en 2014, et l'on peut donc dire que cette publication des cent quatre-vingt-trois Sermons sur l'Écriture fut un événement, sachant qu'il y a en tout cinq cents sermons de la main du saint. À la lecture de cette somme théologique, et malgré une traduction qui aurait eu avantage à être révisée, on est évidemment pris par l'écriture éblouissante de saint Augustin, et l'on découvre avec un plaisir grandissant ce qui nous avait été dissimulé pendant si longtemps. Cette prose, grâce à ses références constantes à la Bible, n'est jamais pesante ni même austère. Il faut voir avec quelle sensibilité esthétique saint Augustin nous parle, deux sermons durant, du Notre Père, cette prière d'une simplicité extrême où le moindre faux pas aurait été sacrilège. Mais non, jusqu'aux confins de l'Apocalypse de Jean, saint Augustin garde une même rigueur fascinante pour nous confirmer ce que, du reste, nous savions déjà : que les Écritures saintes sont l'un des plus beaux réservoirs de littérature qui soit au monde. Et vraiment, l'on se dit qu'il faut posséder dans sa bibliothèque ces Sermons d'une des figures les plus attachantes du christianisme, à côté de ses fameuses Confessions.
Saint Augustin, Sermons sur l'Écriture. Traduction de l'abbé Jean-Baptiste Raulx. Édition établie et préfacée par Maxence Caron. Éd. Laffont, "coll. Bouquins", 2014, 33 €.
11:28 Publié dans Livre | Tags : saint augustin, sermons sur l'écriture, laffont, collection bouquins, maxence caron, la bible, apocalypse de jean, littérature, christianisme | Lien permanent | Commentaires (0)
23/02/2016
La planète cathodique
C'est à l'occasion d'un colloque tenu à Paris en 1997, et consacré très précisément à "Religion et média", que Jacques Derrida fit la communication qui est reprise dans ce bref volume sous le titre Surtout, pas de journalistes ! Le propos, improvisé, de Derrida consiste ici en une introduction générale, suivie de ses réponses à quelques questions de la salle. Le thème était vaste, et le philosophe n'en a pas esquivé la problématique, renvoyant en divers endroits à son ouvrage Foi et Savoir (le Seuil, 1996). Ce qui a retenu mon attention en premier lieu, dans ces quelques pages, c'est la manière dont Derrida aborde la religion, à travers l'exemple biblique bien connu d'Abraham à qui Dieu demande de sacrifier son fils unique. "Qu'est-ce que Dieu, s'interroge Derrida, a dû dire à Abraham ?" Or, cela, nous ne le savons pas, car l'événement n'a pas été médiatisé. Tout est resté secret. Et c'est ce secret, selon Derrida, qui fait l'essence même des religions juive et musulmane, par opposition au christianisme (le Christ, rappelle Derrida, "aura été le premier journaliste ou nouvelliste, comme les évangélistes qui rapportent la bonne nouvelle"). Ainsi, la comparaison entre la propagation actuelle de l'information à l'échelle de la planète et le surgissement d'une religion médiatisée comme le christianisme apparaît à Derrida comme un point crucial : "Au cours d'une messe chrétienne, écrit-il, la chose même, l'événement se passe devant la caméra..." La "venue de la présence réelle" se produit en direct. La retransmission par les caméras de télévision vient d'ailleurs renforcer cet effet de réel religieux si spécifique. Médias et religion décuplent ici leurs forces spectaculaires. Derrida est bien sûr trop intelligent pour s'arrêter là. Néanmoins, il use d'un tel dispositif sans vraiment mettre en question, me semble-t-il, une vision plus complexe de la religion chrétienne. Sauf à un moment, où il est amené à parler de la foi, et à se demander quelle importance elle acquiert en philosophie (en philosophie plutôt que dans la religion). Derrida écrit en effet : "Que veut dire croire à la foi ?" Nous arrivons ici au cœur du problème. Derrida va conserver une "équivoque" certaine face à cette formulation cruciale de la foi : "C'est parce que je crois que l'équivoque est indéniablement là. Nous sommes, je suis [Derrida emploie la première personne du singulier, pour bien montrer qu'il s'agit avant tout de son cas personnel à lui] dans l'équivoque." La religion, pour Derrida, possède un "rapport équivoque à la foi", et on sent donc très bien, à ce stade, ce qui empêche le philosophe d'avancer plus avant dans la comparaison religion/média. Ce n'est pas le moindre intérêt de cette petite conférence de nous faire toucher du doigt une aporie discursive, qui nous fait sortir de la philosophie et accéder au cas propre du penseur qui se met en jeu ici et maintenant.
Jacques Derrida, Surtout, pas de journalistes ! Éd. Galilée, 17 €.
Illustration : Eugenio Carmi
16:46 Publié dans Philosophie | Tags : jacques derrida, surtout, pas de journalistes !, religion, médias, abraham, christianisme, islam, religion juive, télévision, foi, croire, philosophie | Lien permanent | Commentaires (0)
14/05/2015
Emmanuel Todd et les contradictions de l'anthropologie

Parmi les anthropologues français, Emmanuel Todd a toujours fait preuve d'une certaine singularité, sans doute parce que l'université française ne l'a jamais vraiment intégré. C'est peut-être une chance, et le public ne s'y trompe pas, qui lit ses livres avec curiosité. Ceux qui auront été un peu dépités par l'essai de Zemmour, se reporteront avec profit au nouvel essai de Todd, écrit quasiment à chaud dans les quelques mois qui ont suivi les attentats du 7 janvier et la manifestation géante du 11. Pour tous les "Charlie" de France, qui se demandaient pourquoi ils ont manifesté ce jour-là, Emmanuel Todd a concocté une petite explication sociologique qui ne devrait pas les laisser indifférents.
Qui est Charlie ? se présente de fait comme un travail anthropologique, élaboré à partir de l'observation scientifique des structures de la famille et de la religion, qui est la marque de fabrique de l'auteur depuis une quarantaine d'années. Dans les conclusions qu'il en tire, Todd n'hésite cependant pas à donner un tour polémique à son livre, ce qui lui fait prendre par moments des allures de pamphlet. Ceci explique la réception houleuse de ce Qui est Charlie ? dans la presse et même le monde politique, puisque le premier ministre Manuel Carlos Valls n'a pas hésité à proclamer sa détestation outragée.
L'une des cibles d'Emmanuel Todd, on le sait désormais, est l'Europe économique née à Masstricht, décrite volontiers comme la dictature d'une petite élite technocratique qui gère la pauvreté qu'elle a délibérément instituée parmi le peuple en s'enrichissant elle-même sans scrupules. Et quand Todd a vu, le 11 janvier dernier, les foules immenses suivre benoîtement le président socialiste François Hollande ("l'obéissance", comme le caractérise Todd), entouré de Merkel ("la domination, l'austérité"), de David Cameron ("le néolibéralisme"), de Jean-Claude Juncker ("le système bancaire luxembourgeois"), etc., etc., son sang n'a fait qu'un tour. Il n'a donc aujourd'hui pas de mots assez durs pour fustiger ses concitoyens, et c'est là, je crois, un aspect contestable de sa démonstration. Si l'on a assisté par certains aspects à une "hystérie" collective, il n'en demeure pas moins que, dans l'esprit de beaucoup de Français, la manifestation du 11 janvier n'était nullement un acquiescement aveugle, et surtout durable, à l'aventure socialiste menée actuellement d'une manière si désastreuse dans le pays.
L'essai d'Emmanuel Todd repose néanmoins pour l'essentiel sur des considérations anthropologiques, et c'est la partie la plus troublante de son travail, et la plus convaincante aussi. Le sous-titre, "sociologie d'une crise religieuse", nous met sur la voie. Todd examine ainsi l'implantation ancienne du catholicisme dans les régions françaises, et en déduit une survivance symbolique qu'il qualifie de "zombie", et qui, selon lui, manifeste des réflexes anthropologiques "inégalitaires". Cette survivance d'une mentalité passée explique bien des péripéties politiques actuelles. J'ai trouvé, en ce qui me concerne, la démonstration fort probante. Fallait-il pour autant l'élargir vers une généralité absolue ? Todd écrit en effet : "Les forces sociales qui se sont exprimées le 11 janvier sont celles qui avaient fait accepter le traité de Maastricht." Là encore, n'est-ce pas un peu rapide ?
En revanche, ce que Todd a, me semble-t-il, très bien vu, c'est l'importance du phénomène religieux à prendre en considération. Nous avons, d'une part, une religion qui disparaît, le christianisme, et qui peine à offrir des substituts, laissant les individus dans un sentiment d'angoisse vive, assez proche du nihilisme. Et d'autre part, nous assistons en France à l'émergence d'une nouvelle religion, qui pèse déjà 5 % de la population, l'islam. Cette dernière religion est celle d'une minorité, note Emmanuel Todd ; elle est également celle des plus pauvres. Or, elle se voit rejetée de toutes parts, et prise comme bouc émissaire face à tous les problèmes auxquels la société française est confrontée. Todd pousse cette idée très loin, soulignant au passage l'idéologie du laïcisme outrancier, qui va jusqu'à faire du blasphème un devoir : "La République, écrit-il, qu'il s'agissait de refonder [en ce 11 janvier] mettait au centre de ses valeurs le droit au blasphème, avec pour point d'application immédiat le devoir de blasphémer sur le personnage emblématique d'une religion minoritaire, portée par un groupe défavorisé." Qui plus est, et Todd y revient à plusieurs reprises, cet ostracisme qu'il dénonce, et dont les banlieues font les frais, est un terreau particulièrement fertile pour l'antisémitisme.
On pourrait discuter très longuement des thèses qui émaillent l'essai d'Emmanuel Todd, soit pour les contredire, soit pour les approuver plus ou moins. Car leur intérêt n'est-il pas en effet de créer un débat sans hypocrisie ? Jadis, un Baudrillard savait prendre ainsi à revers tous les préjugés, mais avec plus d'humour, et de cynisme, comme pour nous dire : "De toute façon, c'est foutu !" Cela passait malgré tout avec davantage de souplesse. Je regrette surtout qu'Emmanuel Todd ne fasse pas de plus amples références à la philosophie. Dans Qui est Charlie ? aucun philosophe n'est cité, aucune pensée fondatrice n'est convoquée pour donner quelque plus large vision d'ensemble. Un sociologue comme Pierre Bourdieu, par exemple, se référait de manière centrale à Kant. Emmanuel Todd évolue dans le monde clos de sa spécialité, n'en sortant, on l'a vu, que pour tirer des leçons qui auraient mérité davantage de nuances. Une certaine dialectique lui fait défaut. Mais il faut bien sûr lire son livre malgré tout passionnant, extrêmement intelligent, qui est un travail unique en ces temps de conformisme idéologique. La gravité de la situation nous y invite plus que jamais.
Emmanuel Todd, Qui est Charlie ? Sociologie d'une crise religieuse. Éd. du Seuil, 18 €.
13:06 Publié dans Livre | Tags : emmanuel todd, qui est charlie ?, anthropologie, éric zemmour, charlie hebdo, sociologie, structures familiales, religion, manuel valls, europe, manifestation du 11 janvier, françois hollande, angela merkel, david cameron, jean-claude juncker, attentats du 7 janvier, hystérie collective, socialisme, catholicisme, mentalités, angoisse, nihilisme, maastricht, christianisme, islam, blasphème, banlieues, antisémitisme, jean baudrillard, pierre bourdieu, kant, philosophie, conformisme idéologique | Lien permanent | Commentaires (0)
13/12/2014
Un temps sans promesses

La fatalité de l'histoire humaine est de s'être déroulée au fil d'une incessante phase de troubles, qui s'est accélérée à l'époque moderne de manière à donner ce que l'on nomme un monde en "crise" (1). Là-dedans, l'homme a tenté, par différents moyens, de se sauvegarder, sans empêcher pour autant le pire de dominer. Et pourtant, des outils lui étaient proposés ; mais sans qu'il sache toujours les utiliser avec discernement. Le logos d'Héraclite, tel qu'on le trouve défini dans un fragment retrouvé, laisse apparaître l'aspect d'insuffisance de l'esprit humain : "Or du discours qui est celui-ci, les hommes vivent toujours loin par l'intelligence, avant d'écouter, comme après qu'ils l'ont écouté une première fois." Ce passage m'a toujours fait penser au logos de saint Jean, qui compare le Verbe à une lumière dont les hommes auraient refusé l'éclat : "Elle a été dans le monde, le monde fait par elle, et le monde ne l'a pas reconnue." Ce refus de la lumière va même, on le sait, jusqu'à la mort de Dieu, sur quoi est fondée la religion (2) – et dont Nietzsche a su si bien décrire les effets. Je lisais dernièrement un texte assez remarquable du pape Benoît XVI, La Parole de Dieu (3). Remarquable, en ce sens qu'il n'élude pas la question, évoquant le "silence" de Dieu, silence énigmatique, profondément troublant pour le croyant et pour l'incroyant : "Comme le montre la croix du Christ, écrivait le pape, Dieu parle aussi à travers son silence." C'est même, poursuit-il, "une étape décisive du parcours terrestre du Fils de Dieu, Parole incarnée." Une "étape", mais aussi une épreuve pour l'homme lui-même "qui, après avoir écouté et reconnu la Parole de Dieu, doit aussi se mesurer avec son silence", comme le dit encore Benoît XVI. Nietzsche a eu raison de diagnostiquer dans la religion chrétienne une sorte de nihilisme. Le christianisme s'est sans doute imposé parce qu'il était, malgré tout, une réaction possible à la situation de crise dont je parlais au début. Il a su s'adapter à l'absence de réponse – au silence même de Dieu.
(1) Voir Myriam Revault d'Allonnes, La Crise sans fin, Essai sur l'expérience moderne du temps. Éd. du Seuil, 2012. (2) Voir Jacques Derrida, Foi et Savoir. Éd. du Seuil, coll. "Points", 2001. (3) Benoît XVI, La Parole de Dieu. Exhortation apostolique Verbum Domini, 30 septembre 2010.
Illustration : image du film Les Communiants (1962) d'Ingmar Bergman, avec Gunnar Björnstrand.
10:50 Publié dans Philosophie | Tags : histoire, crise, myriam revault d'allonnes, logos, héraclite, fragment, saint jean, verbe, lumière, mort de dieu, nietzsche, benoît xvi, exhortation apostolique verbum domini, la parole de dieu, silence, la croix, nihilisme, christianisme, religion, jacques derrida, foi et savoir, ingmar bergman, les communiants | Lien permanent | Commentaires (0)
25/03/2014
Notre nihilisme
 Dans son numéro de mars-avril, la revue Esprit a l'apparente bonne idée de nous parler du nihilisme. Plus précisément de "notre nihilisme". Car, depuis deux siècles au moins, le nihilisme nous possède, et l'on ne peut faire l'impasse sur lui, sous peine de ne rien comprendre. Nietzsche en a établi la généalogie, et le faisait remonter au christianisme qui, en dévaluant le monde réel au profit d'un mirage religieux, nous aurait plongés dans le désespoir et la noirceur. Depuis, nous vivons dans un monde où les valeurs s'évaporent dangereusement. Les articles de cette revue Esprit essaient, non sans mal, de faire le tour de la question. L'interview de Jean-Luc Nancy (photo) a cependant retenu mon attention. Présenté comme l'héritier du philosophe Jacques Derrida, il offre ici un large panorama historique de la pensée nihiliste, auquel le lecteur peut se référer. Je retiendrai quelques propos sur Maurice Blanchot, pierre angulaire du nihilisme, et auquel Nancy va bientôt consacrer un nouveau livre. "Je n'aime pas les récits de Blanchot, confie-t-il, pas au sens où ce n'est pas mon goût, mais parce qu'ils exposent constamment un refus du récit — grande affaire blanchotienne — parce que le récit porte quelque chose du contingent, de l'accidentel, de la transformation alors que le non-récit de Blanchot pense montrer une pleine présence." Déclaration intéressante, mais que je me permets de contredire immédiatement : je trouve au contraire effective cette "pleine présence" dans les récits de Blanchot. La critique de Nancy a néanmoins l'avantage de préciser la question — qui est bel et bien la question de la modernité, et donc, par voie de conséquence plus ou moins directe, la question du nihilisme. C'est en ces termes qu'on doit à mon avis la poser, et non pas, par exemple, en dissuadant à cor et à cri les lecteurs de lire le Catéchisme de l'Eglise catholique, comme le font dans ce numéro les auteurs d'Esprit, revue pourtant influencée par le personnalisme chrétien d'Emmanuel Mounier ! Un autre article m'a plutôt intéressé : "Al-Quaida et le nihilisme des jeunes", par Olivier Roy, spécialiste de l'islam. Sa thèse est que les attentats-suicides perpétrés par de jeunes musulmans sont "une question de génération" plus que de religion. La société mondialisée sécrète des conditions de vie complètement aberrantes, centrées sur un matérialisme appauvrissant qui ne laisse aucune place à la dimension spirituelle. Les jeunes sont facilement désespérés par un tel état de fait, et, qu'ils habitent un pays arabe ou aux Etats-Unis, ils sont pour cette raison susceptibles de passer d'autant plus volontiers à l'action violente, au sacrifice ultime de leur vie comme acte de résistance. Ils se révoltent en fin de compte contre des "formes de nihilisme", dont l'empire s'impose à eux sans autre remède possible; du moins le croient-ils. Je me souviens d'un film de Bruno Dumont, Hadewijch, en 2008, qui montrait avec une pertinence remarquable ce processus à l'œuvre chez une jeune fille (jouée par Julie Sokolowski). Chrétienne fanatique, elle se rapprochait de jeunes amis islamistes afin de commettre un attentat. Bruno Dumont montrait avec finesse la lente dérive de son héroïne perdue, sans complaisance ni répulsion. C'était un portrait très touchant, démonstration parfaite d'un nihilisme qui contamine tout, en une surenchère perpétuelle qui aboutit à la catastrophe. Cercle vicieux dont il ne sera pas facile de sortir !
Dans son numéro de mars-avril, la revue Esprit a l'apparente bonne idée de nous parler du nihilisme. Plus précisément de "notre nihilisme". Car, depuis deux siècles au moins, le nihilisme nous possède, et l'on ne peut faire l'impasse sur lui, sous peine de ne rien comprendre. Nietzsche en a établi la généalogie, et le faisait remonter au christianisme qui, en dévaluant le monde réel au profit d'un mirage religieux, nous aurait plongés dans le désespoir et la noirceur. Depuis, nous vivons dans un monde où les valeurs s'évaporent dangereusement. Les articles de cette revue Esprit essaient, non sans mal, de faire le tour de la question. L'interview de Jean-Luc Nancy (photo) a cependant retenu mon attention. Présenté comme l'héritier du philosophe Jacques Derrida, il offre ici un large panorama historique de la pensée nihiliste, auquel le lecteur peut se référer. Je retiendrai quelques propos sur Maurice Blanchot, pierre angulaire du nihilisme, et auquel Nancy va bientôt consacrer un nouveau livre. "Je n'aime pas les récits de Blanchot, confie-t-il, pas au sens où ce n'est pas mon goût, mais parce qu'ils exposent constamment un refus du récit — grande affaire blanchotienne — parce que le récit porte quelque chose du contingent, de l'accidentel, de la transformation alors que le non-récit de Blanchot pense montrer une pleine présence." Déclaration intéressante, mais que je me permets de contredire immédiatement : je trouve au contraire effective cette "pleine présence" dans les récits de Blanchot. La critique de Nancy a néanmoins l'avantage de préciser la question — qui est bel et bien la question de la modernité, et donc, par voie de conséquence plus ou moins directe, la question du nihilisme. C'est en ces termes qu'on doit à mon avis la poser, et non pas, par exemple, en dissuadant à cor et à cri les lecteurs de lire le Catéchisme de l'Eglise catholique, comme le font dans ce numéro les auteurs d'Esprit, revue pourtant influencée par le personnalisme chrétien d'Emmanuel Mounier ! Un autre article m'a plutôt intéressé : "Al-Quaida et le nihilisme des jeunes", par Olivier Roy, spécialiste de l'islam. Sa thèse est que les attentats-suicides perpétrés par de jeunes musulmans sont "une question de génération" plus que de religion. La société mondialisée sécrète des conditions de vie complètement aberrantes, centrées sur un matérialisme appauvrissant qui ne laisse aucune place à la dimension spirituelle. Les jeunes sont facilement désespérés par un tel état de fait, et, qu'ils habitent un pays arabe ou aux Etats-Unis, ils sont pour cette raison susceptibles de passer d'autant plus volontiers à l'action violente, au sacrifice ultime de leur vie comme acte de résistance. Ils se révoltent en fin de compte contre des "formes de nihilisme", dont l'empire s'impose à eux sans autre remède possible; du moins le croient-ils. Je me souviens d'un film de Bruno Dumont, Hadewijch, en 2008, qui montrait avec une pertinence remarquable ce processus à l'œuvre chez une jeune fille (jouée par Julie Sokolowski). Chrétienne fanatique, elle se rapprochait de jeunes amis islamistes afin de commettre un attentat. Bruno Dumont montrait avec finesse la lente dérive de son héroïne perdue, sans complaisance ni répulsion. C'était un portrait très touchant, démonstration parfaite d'un nihilisme qui contamine tout, en une surenchère perpétuelle qui aboutit à la catastrophe. Cercle vicieux dont il ne sera pas facile de sortir !
Esprit, "Notre nihilisme", n° 403 , mars-avril 2014. 20 €.
07:30 Publié dans Philosophie | Tags : revue esprit, notre nihilisme, nihilisme, nietzsche, généalogie, christianisme, désespoir, jean-luc nancy, jacques derrida, maurice blanchot, modernité, catéchisme de l'église catholique, emmanuel mounier, al-quaida, olivier roy, islam, attentats suicides, matérialisme, mondialisation, pays arabes, états-unis, résistance, bruno dumont, hadewijch, julie sokolowski, dérive | Lien permanent | Commentaires (0)