11/11/2022
Suggestions de lectures
Dix livres à lire ou relire prochainement
L’Homme de Londres, de Simenon
Roman très cinématographique, adapté par le réalisateur hongrois Béla Tarr en 2007, sur un scénario de son complice, le romancier László Krasznahorkai.
Guerre & guerre, de László Krasznahorkai
Une œuvre romanesque qui promet une originalité très grande, et qui, en même temps, se présente comme fondamentalement européenne.
Si l’Europe s’éveille, de Peter Sloterdijk
Un essai sur un continent en crise d’identité, qui espère en un sursaut. Loin des apologies d’une certaine Nouvelle droite, et donc sans nostalgie de la révolution conservatrice allemande du début du XXe siècle.
Sur Maurice Blanchot, d’Emmanuel Levinas
En une centaine de pages, un tour d’horizon fécond de l’œuvre de Blanchot, par un très grand philosophe qui fut son ami.
Dora, in Cinq psychanalyses, de Freud
Très belle analyse de l’hystérie, toujours d’actualité.
Méditations pascaliennes, de Pierre Bourdieu
Le maître livre du sociologue français. Pour comprendre le monde dans lequel on vit.
Le Sophiste, de Platon
Une pensée sur l’ontologie, qui fascina Heidegger.
Histoire d’une vie, d’Aharon Appelfeld
Contrairement à ce qu’estimait Philip Roth, l’œuvre d’Appelfeld me semble se nourrir au creuset européen de l’avant-guerre, un monde englouti dont nous portons les stigmates.
Le Bruit et la fureur, de Faulkner
L’Amérique, c’est-à-dire la « déconstruction », comme le disait Jacques Derrida.
La Trêve, de Primo Levi
Pas seulement un rescapé, mais aussi un des plus grands écrivains européens de l’après-guerre.
07:23 Publié dans Livre | Tags : simenon, krasznahorkai, sloterdijk, levinas, freud, bourdieu, platon, appelfeld, faulkner, primo levi | Lien permanent | Commentaires (0)
29/03/2022
Un nouveau livre du romancier français
La vérité sur Philippe Sollers
Il a toujours été difficile d’avoir des idées claires sur Philippe Sollers. L’écrivain a abordé tous les genres de littératures, inspiré par les plus illustres auteurs classiques, de Dante à James Joyce. Surtout, il a eu la faculté, depuis quasiment ses débuts, de côtoyer les avant-gardes du moment, en en devenant souvent la tête pensante, voire l’un des chefs revendiqués. Le surréalisme l’avait beaucoup intéressé, il portait une grande admiration à André Breton. Puis, le jeune mouvement autour de la revue Tel Quel, dont il fut l’un des fondateurs, l’a longuement retenu, et s’adaptait fort bien, en politique, à son maoïsme sans retenue, étiquette lourde à porter par la suite. La concurrence avec le mouvement situationniste se dénoua, à partir des années 80, par une admiration sincère pour Guy Debord, qu’il invita plus tard à se faire publier aux éditions Gallimard. En 1983, le roman Femmes avait permis à Sollers de se recentrer sur une littérature plus « conservatrice », faite, plus que jamais, de références aux grands auteurs, mais aussi de libertinage tous azimuts.
Aujourd’hui très âgé, Sollers continue de publier chaque année des sortes de romans-essais, dans lesquels il médite à partir de ses lectures récentes ‒ il a en effet constamment été un grand lecteur et un remarquable critique. Le volume, cette année, ne comporte qu’une soixantaine de pages et s’intitule Graal, comme s’il s’agissait presque d’un chant du cygne. C’est cependant un texte très significatif, indubitablement, qui mélange avec une sincérité désarmante les grands thèmes du Sollers que nous connaissons, mais en donnant des clefs véridiques. La vieillesse n’a fait que conforter le légendaire « libertin » des lettres, semble-t-il, qui a compris que, désormais, s’apprêtant à jouer son dernier coup d’archet, il rentrait dans la phase des aveux et de la confession ultime. Il y a dans cette prose raffinée de Graal un émouvant tremblé ‒ comme dans l’écriture manuelle de certains vieillards épuisés par la vie, mais désirant néanmoins toujours en jouir, du haut de leur siècle incertain. Cette écriture, d’ailleurs, ressemble à la mienne, désormais.
On savait Sollers adepte et admirateur d’un certain illuminisme qui traversa notamment le XVIIIe, son siècle de prédilection. Dans Graal, notre auteur, allant plus loin, nous donne le fin mot : « Mon anomalie génétique inexpliquée est connue depuis longtemps des spécialistes. […] je suis un Atlante, ce qui expliquerait la plus grande partie de mes bizarreries. » Eh oui ! Vous avez bien lu. Un « Atlante », c’est-à-dire un de ces humains issus de l’Atlantide, ce continent mystérieux, englouti il y a plusieurs millénaires au moins. Platon l’évoque dans le Timée et le Critias. L’Atlantide a donné lieu, à travers les siècles, à toutes sortes d’interprétations ou de délires pseudo-scientifiques.
Sollers, inspiré par un ouvrage rare du XVIIIe siècle, Les Mystères sexuels de l’Atlantide, va insister sur le type d’initiation que lui-même aurait reçu. C’est une initiation incestueuse et très libertine : « les femmes atlantes apprennent très tôt aux jeunes garçons à se caresser pour imiter les femmes en train de se donner du plaisir. […] Ce sont bien les mères et les tantes qui se chargent volontiers de cet événement qui marque à vie les jeunes mâles. » Et Sollers de revenir à l’envi sur sa propre initiation charnelle avec sa tante, qu’il avait déjà racontée à mots couverts dans Femmes, si je me souviens bien.
À partir de cette scène inaugurale, l’imagination de Sollers vagabonde, de manière érudite, grâce à toute une série de textes anciens qu’il cite généreusement. Pour lui, la plupart des grands hommes qui ont marqué l’humanité étaient des Atlantes. Le Christ par exemple, sur lequel Sollers ne tarit pas d’éloges (notre libertin est aussi un grand catholique romain). Ou encore, saint Jean, fondateur de « l’Église invisible », auteur mythique d’un Évangile gnostique. « Que fait Jean, écrit Sollers, à la fois mort et vivant, pendant tout ce temps ? Il n’y a qu’une seule réponse : il garde le Graal, mais où et comment ? La réponse est au début de son Évangile, à condition de bien le comprendre et en le traduisant au présent : Au commencement est le Verbe... »
Sollers a souvent affirmé qu’il aimait beaucoup l’écrivain ésotérique René Guénon. Je suis moi-même un lecteur de Guénon (en particulier du Roi du Monde, disponible aux éditions Gallimard). J’aime les constructions symboliques, qui nous mettent sur le chemin de la véritable tradition. Bien sûr, Sollers nous parle de tout ceci avec un « moi » très amplifié, le sien, qui déforme sans doute un peu la doctrine originelle. Il se rapproche peut-être, ce faisant, d’un René Daumal et de son fascinant Mont Analogue. Au fond, dans Graal, Sollers nous donne une belle leçon de subjectivité romanesque. Car le « romanesque » est là, dans cet effort de Sollers d’aller au plus profond de soi, pour se connaître enfin. Expérience essentielle et bien connue, mais rarement réalisée de nos jours. Il y faut sans doute toute une vie.
Philippe Sollers, Graal. Éd. Gallimard, 12 €.
06:43 Publié dans Livre | Tags : philippe sollers, tel quel, guy debord, libertin, graal, illuminisme, atlantide, platon, timée, textes anciens, saint jean, rené guénon, rené daumal | Lien permanent | Commentaires (0)
02/09/2020
Pascal Quignard, le questionnement de l'intime
Lire, selon Heidegger
En lisant cet été un très beau commentaire de Heidegger sur le mythe de la caverne de Platon, dans De l'essence de la vérité, je suis tombé sur cette phrase qui m'a fait longuement réfléchir et a littéralement "rafraîchi" mon esprit, face au surmenage imminent de la prochaine rentrée avec ses piles de livres à foison. À la fin de son cours, après avoir détaillé sa lecture de Platon, Heidegger lance à ses étudiants une sorte d'invocation absolue. Il leur dit : "Au cas où vous éprouveriez encore le besoin irrépressible de lire la littérature philosophique paraissant aujourd'hui, c'est le signe infaillible de ce que vous n'avez rien compris à ce qui s'est passé devant vous." Selon Heidegger, lire et étudier un dialogue de Platon suffisait amplement, à condition sans doute, comme il l'ajoute, toujours à son jeune auditoire, "que vous ayez en vous un questionnement éveillé, mis en éveil au plus profond de votre intimité". Il me semble que, certes, l'on peut ne pas être tout à fait d'accord avec cette injonction de Heidegger. Néanmoins, il a le mérite de pointer du doigt un phénomène essentiel de la littérature, en mettant en question les livres qui nourrissent réellement l'esprit, et les autres. Au lecteur de rester "éveillé", et de faire confiance à sa culture pour dominer une matière si complexe.
Qu'est-ce qu'un lettré ?
Le nouveau livre de Pascal Quignard, qui paraît à cette rentrée, L'Homme aux trois lettres, va nous apporter des éléments de réponse assez cruciaux. On connaît déjà l'œuvre de cet auteur très érudit, qui n'hésite pas à prendre ses exemples dans la vieille littérature latine ou chinoise, entre autres. Quignard est notre dernier lettré, selon une tradition qui remonte à la nuit des temps. Ses livres sont parsemés de citations exquises, puisées dans les textes les plus anciens et, parfois, les plus méconnus. L'Homme aux trois lettres, onzième volume de la série "Dernier royaume", est d'autant plus intéressant que Quignard y fait le bilan de son activité passionnée de lecteur.
Un jour, alors que sa vie professionnelle dans le milieu de l'édition était pourtant intense et riche, Pascal Quignard a soudainement tout plaqué. Nous étions en 1994, et, comme le Bouddha, qui de prince devint mendiant, après une illumination, Quignard décida de se consacrer exclusivement à la lecture des livres. Je dois dire que cette résolution radicale me fascine beaucoup, tant je la trouve exemplaire et unique. Je la partage entièrement. Qui d'autre se serait comporté ainsi, avec autant de détermination, à cette époque ?
Incontestablement, le jeu en valait la chandelle. Et Quignard de nous relater dans ses écrits tous les bienfaits d'un otium qui désormais remplissait sa vie, au milieu des livres. Dans L'Homme aux trois lettres, il s'attarde longuement, en plusieurs chapitres, sur ce désœuvrement du lettré, nous confiant ainsi : "Ceux qui s'adonnent à cette activité si totalement désintéressée à l'activité immédiate distancent à jamais les autres classes sociales par une application de plus en plus dense, volontaire, ardue, fervente, astreignante, approfondissante, interminable. Luxe pur." Très beau passage, il me semble, qui dit l'originalité d'un choix, et peut-être même davantage qu'un choix : une éthique. Quignard, pour illustrer ceci de manière originale, va chercher un vocable inusité, qui exprime le repos, la solitude et le silence de la lecture : "requoy" (ou parfois "recoy"). Quignard nous le commente ainsi : "Il est peut-être le mot clé du livre que j'écris. Il définit si précisément la lecture car il mêle le silence (la lecture coite) et le recoin, le retrait, le repos (le requiem, le requoy)."
Saint Augustin et saint Ambroise
À propos de la lecture, Quignard rapporte au début de son livre l'épisode des Confessions de saint Augustin, qui se passe à Milan, dans lequel celui-ci, alors tout jeune, raconte son émerveillement devant Ambroise lisant un livre en silence. Cette belle anecdote m'apparaît comme particulièrement emblématique de la pensée que veut nous faire partager Quignard dans L'Homme aux trois lettres. Il lui suffit, je crois, de citer ce que saint Augustin lui-même écrit de son intention en rapportant ce récit : Augustin veut nous faire mesurer, selon ses propres termes, "la profondeur de l'abîme d'où nos cris doivent provenir afin de s'élever vers toi" (je rappelle qu'Augustin s'adresse à Dieu).
Comment sera reçu cet ouvrage de Pascal Quignard, à une époque de consumérisme extravagant, dans laquelle la littérature est considérée par le public comme un simple divertissement ? Il faut assurément revenir ici à la déclaration prophétique de Heidegger, par laquelle j'ai commencé mon propos. La lecture de Quignard, si riche, si essentielle, si fidèle à la grande tradition littéraire, peut nous mettre en éveil au plus profond de notre intimité, pour reprendre les termes du philosophe. Et ceci constitue incontestablement un grand bien, et le début d'un long cheminement sur un sentier escarpé, vers les hauteurs, vers la lumière.
Pascal Quignard, L'Homme aux trois lettres. Éd. Grasset, 18 €.
09:29 Publié dans Livre | Tags : pascal quignard, l'homme aux trois lettres, dernier royaume, heidegger, platon, lettré, bouddha, éthique, lumière | Lien permanent | Commentaires (1)
21/09/2017
Claudio Magris, Prix Nobel ?
La date d'attribution du Prix Nobel de littérature 2017 n'est pas encore déterminée, mais déjà les pronostics vont bon train. Parmi les favoris, j'ai la joie de compter l'écrivain italien Claudio Magris, à qui je voue, mais je ne suis pas le seul, une grande admiration. En 1993, déjà, j'avais lu avec passion son très beau roman, Une autre mer, qui reste un de mes préférés, et lui avais consacré un article, paru en revue. Pour rendre hommage aujourd'hui à Claudio Magris de nouveau, à la veille peut-être d'un couronnement Nobel (j'accorde une certaine importance à ce prix), je reprends ce texte ici.
On peut considérer que l'œuvre de Claudio Magris trouve sa source dans la singularité de la ville où il est né, cette Trieste qui a marqué d'une empreinte indélébile tous ceux qui même n'y ont fait que passer tel James Joyce. Claudio Magris a d'ailleurs écrit un essai sur Trieste, Trieste, une identité de frontière (en collaboration avec Angelo Ara) alors que d'autres ouvrages soulignaient la proximité de Trieste avec la Mitteleuropa (notamment Danube, prix du meilleur livre étranger 1990).
Mais Claudio Magris est également un grand romancier, comme l'atteste Une autre mer. L'écrivain révèle dans ces pages les principales arcanes de son univers triestin, en prenant comme sujet central la figure, pourtant absente, du début à la fin, de Carlo Michelstaedter, jeune philosophe italien de Trieste, qui a réellement vécu (comme les autres personnages du roman), et qui s'est suicidé en 1910 à l'âge de vingt-deux ans, après avoir achevé sa thèse, fameuse depuis, La Persuasion et la rhétorique ; une destinée similaire à celle de l'Autrichien Otto Weininger, comme l'on sait.
À cette décision extrême de la mort volontaire, correspond celle d'Enrico, protagoniste principal d'Une autre mer, qui est de s'enfuir en Argentine ; car si l'un se supprime après avoir couché sa philosophie sur le papier, l'autre (son meilleur ami) choisit d'appliquer cette philosophie dans la vie réelle, tout en renonçant pour sa part à l'écriture. Le nœud et la réflexion du livre tiennent dans cette asymétrie.
Claudio Magris intègre remarquablement, dans le corps de son texte, la philosophie de Michelstaedter. Il ne se contente pas de l'illustrer, il en exprime la teneur avec une précision lumineuse. La persuasion, écrit Magris, "c'est la possession au présent de sa propre vie et de sa propre personne, la capacité de vivre pleinement l'instant..." ; malheureusement, les "hommes sont incapables de vivre dans la persuasion", et à la place, ils "édifient l'énorme muraille de la rhétorique, l'organisation sociale du travail et de l'agir, pour se cacher à eux-mêmes la vue et la conscience de leur propre vacuité".
En Argentine, Enrico a vécu selon l'éthique de l'ami disparu. Quand il revient en Italie, quelques années plus tard, il s'installe dans une petite maison près de la mer où il vivra quasiment en ermite, dans la pauvreté : "le plaisir, c'est de ne pas dépendre des choses qui ne sont pas absolument nécessaires, et même celles qui le sont peuvent être accueillies avec indifférence".
Cependant, malgré son retrait délibéré, l'Histoire rattrape Enrico. L'historien Claudio Magris cerne très lisiblement les événements et leur portée. Ainsi, sur le nazisme, il écrit (dans l'esprit de Michelstaedter) : "Voilà, ce Reich millénaire est la preuve que la rhétorique est mort et destruction..." Enrico assiste à la lente déshumanisation de la civilisation européenne, à son échec ; et il se persuade que décidément "la vie est insolvable", même si l'on fait le choix de vivre dans la philosophie. Bouddha, Platon... n'y changent rien, le processus est irréversible. Au soir de son existence, il constate : "Je n'ai vécu que l'impuissance à vivre."
C'est donc bien Carlo qui a eu raison de renoncer : d'où probablement le sentiment tenace que laisse la lecture de ce livre très riche, et très simple dans son évidence.
Une autre mer, Claudio Magris. Traduit de l'italien par Jean et Marie-Noëlle Pastureau. Éd. Gallimard, 1993. Réédition collection "Folio", 2011.
09:51 Publié dans Livre | Tags : claudio magris, une autre mer, prix nobel de littérature, trieste, james joyce, mitteleuropa, trieste une identité de frontière, carlo michelstaedter, otto weininger, rhétorique, histoire, roman, platon, bouddha, suicide, europe | Lien permanent | Commentaires (0)
19/03/2015
Nietzsche, Heidegger et le nihilisme
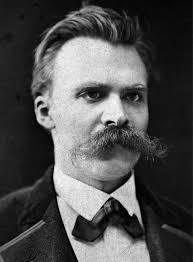
Heidegger estimait que c'était avec Nietzsche que se clôturait l'histoire de la métaphysique, dont Platon avait ouvert le cours. Nietzsche a établi en effet la remise en cause des "valeurs", sur lesquelles était fondée la civilisation occidentale. "La mort de Dieu" résume ce tournant. Heidegger le met aussitôt en relation avec un autre concept nietzschéen, "la volonté de puissance", qui lui semble adéquat pour créer des valeurs nouvelles à partir du champ de ruines. On perçoit évidemment ici le danger, en quelque sorte l'arbitraire, qui peut en résulter. La pensée de Nietzsche recélait des virtualités, dont lui-même aurait certainement été effrayé s'il avait pu savoir que par la suite elles seraient "récupérées" de la sorte. Heidegger a cru que l'avènement du nazisme était propice au règne de "valeurs" à réinventer, et que celles-ci allaient éclore sur les terres fumantes de nihilisme du IIIe Reich. Heidegger écrivait par exemple dans son cours sur Nietzsche du semestre 1941-1942 : "il faut que toute participation humaine à l'accomplissement du nouvel ordre porte en soi l'insigne de la totalité" [souligné par moi]. Heidegger mène très loin les idées de Nietzsche, profitant de leur nature antidémocratique. L'histoire devait cependant donner tort à Heidegger et à son exploitation philosophique du "nihilisme extrême". Il n'en reste pas moins que l'ordre démocratique qui s'installa après la guerre ne résolut pas entièrement la question ; et qu'il la laissa même en plan, dans une sorte d'ambiguïté fondamentale, qui fit que le nihilisme put encore avoir de beaux jours devant lui. Je préfère sans doute cette tranquillité imparfaite, toute nihiliste soit-elle. Elle n'interdit pas par exemple, quant à elle, le retour à quelques traditions anciennes, pour tenter d'apporter des réponses pacifiques au malaise qui continue. Le nihilisme n'a pas été qu'une crise passagère, la métaphysique elle-même en a été affectée, comme ont su le reconnaître Nietzsche, et Heidegger à sa suite. Mais le diagnostic seul était bon ; il reste toujours à l'homme la tâche si périlleuse de trouver les remèdes appropriés à ce mal profond, qui ne cesse pas. Enjeu très incertain, comme je le pense, face au monde moderne.
Illustration : photographie de Nietzsche
11:46 Publié dans Philosophie | Tags : nietzsche, heidegger, platon, la mort de dieu, histoire, valeurs, civilisation occidentale, nihilisme, nazisme, troisième reich, démocratie, nihilisme extrême, traditions, métaphysique, monde moderne | Lien permanent | Commentaires (0)
05/02/2014
Philosopher
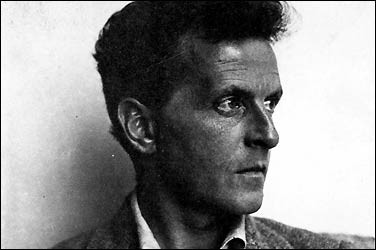
La philosophie est à mon sens un art du discours. Lorsqu'on critique la rhétorique, comme Platon dans le Gorgias, on n'en utilise pas moins une pensée discursive. L'antirhétorique est elle-même une rhétorique, certes d'un niveau fort supérieur. Les grands philosophes m'ont toujours semblé écrire dans une langue très belle, très littéraire. C'est au fond une langue qu'il faut apprendre, et s'approprier, si l'on veut comprendre comment s'agence le discours philosophique. La pensée moderne, plus qu'une autre, consiste dans cet art de dire : non pour prouver quoi que ce soit, peut-être, mais pour déployer un raisonnement au terme duquel aucune vérité n'émergera. La seule vérité, ou les vérités, plutôt, se trouvent potentiellement dans l'espace du discours. Il a fallu des siècles pour pressentir cette richesse dans l'immobilité de la pensée, même si la dette envers les auteurs anciens doit être constamment reconnue. Cette immobilité était déjà en germe chez Epicure (qui n'a pas voulu faire œuvre, comme on sait) et combien d'autres. Quand j'avais lu par exemple les Leçons sur la liberté de la volonté de Wittgenstein, j'avais constaté avec délectation que Wittgenstein ne proposait aucune doctrine sur le libre arbitre. Dans ses leçons, tout simplement, le but n'était pas de conclure. Voilà en fait ce qu'il fallait comprendre !
17:59 Publié dans Philosophie | Tags : philosophie, art du discours, platon, gorgias, rhétorique, littéraire, pensée moderne, vérité, immobilité, épicure, wittgenstein, leçons sur la liberté de la volonté, ne pas conclure | Lien permanent | Commentaires (0)
