16/10/2016
Patrick Buisson, conseiller du Prince

Le gros essai de Patrick Buisson, La Cause du peuple, a fait l'objet d'un très vif débat dans la sphère médiatique. L'homme avait tout pour déplaire : venant de l'extrême droite, et y demeurant toujours ; sans parler de l'enregistrement secret de ses conversations professionnelles. Bref, la parution de son livre a suscité un beau tollé, qui s'est éteint de lui-même lorsqu'il a fallu constater que l'ouvrage était une véritable réflexion politique sur plus de 400 pages, vaste projet placé sous l'invocation du cardinal de Retz, autre défenseur des causes perdues. Il en aurait certainement fallu moins pour m'inciter à lire cet essai, et j'avoue que je n'ai pas été déçu. J'ai toujours eu un a priori positif pour les visions alternatives de la politique. Cette fois, je suis servi. Le fait pour Buisson d'avoir été, pendant plus d'un quinquennat, le conseiller presque le plus proche du plus haut personnage de l'État donne à son témoignage une valeur incontestable, loin de toute utilisation trop people de ce qu'il a pu par ailleurs observer. Un mémorialiste n'est-il pas là pour révéler une réalité cachée, afin de faire éclater la vérité ? Les révélations ici sont plutôt d'ordre politique, même si l'homme Nicolas Sarkozy en prend évidemment pour son grade : "l'homme public, écrit Buisson de Sarkozy, malgré l'appel qu'il sentait sourdre en lui, fut toujours contraint par l'homme privé, ses passions, ses désordres, ses coupables faiblesses pour l'air du temps et les fragrances de la modernité". Issu d'une droite dont les perspectives n'étaient pas celles du président Sarkozy, mais dont celui-ci eut besoin pour rameuter vers lui l'électorat FN, Patrick Buisson développa une stratégie très rationnelle pour faire vaincre ses idées – que je ne partage pas toutes, soit dit en passant. Il y avait chez lui, ce qui est rare dans ce monde-là, une absolue sincérité qu'il portait depuis toujours et qui transparaît dans ce livre au fil d'analyses tout à fait passionnantes. Il redit peut-être par moments ce que nous savions déjà, mais en montrant comment on l'éprouve du cœur de l'État : "le néolibéralisme, ose-t-il définir, est bien une forme économique du totalitarisme, tout comme le nazisme et le communisme en ont été au XXe siècle les formes politiques". Quant à notre malheureux régime démocratique, il ne vaut pas cher non plus : "Il s'agit en fait, écrit Buisson, d'une postdémocratie qui n'est en rien une démocratie, mais un système qui en usurpe l'appellation et n'en respecte que les apparences." On ne peut que se réjouir qu'un tel brûlot sorte en période électorale. Voilà indiscutablement le livre qu'il faudra avoir lu avant de mettre son bulletin dans l'urne. Plus globalement, ce sont les Mémoires étonnants d'un conseiller du Prince, grand politologue, qui a décidé de tout dire sur une histoire contemporaine qui est, hélas ! toujours la nôtre au moment où j'écris ces lignes.
Patrick Buisson, La Cause du peuple. Éd. Perrin, 21,90 €.
07:22 Publié dans Histoire | Tags : patrick buisson, la cause du peuple, cardinal de retz, nicolas sarkozy, front national, néolibéralisme, démocratie, post-démocratie | Lien permanent | Commentaires (1)
19/03/2015
Nietzsche, Heidegger et le nihilisme
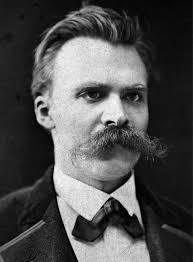
Heidegger estimait que c'était avec Nietzsche que se clôturait l'histoire de la métaphysique, dont Platon avait ouvert le cours. Nietzsche a établi en effet la remise en cause des "valeurs", sur lesquelles était fondée la civilisation occidentale. "La mort de Dieu" résume ce tournant. Heidegger le met aussitôt en relation avec un autre concept nietzschéen, "la volonté de puissance", qui lui semble adéquat pour créer des valeurs nouvelles à partir du champ de ruines. On perçoit évidemment ici le danger, en quelque sorte l'arbitraire, qui peut en résulter. La pensée de Nietzsche recélait des virtualités, dont lui-même aurait certainement été effrayé s'il avait pu savoir que par la suite elles seraient "récupérées" de la sorte. Heidegger a cru que l'avènement du nazisme était propice au règne de "valeurs" à réinventer, et que celles-ci allaient éclore sur les terres fumantes de nihilisme du IIIe Reich. Heidegger écrivait par exemple dans son cours sur Nietzsche du semestre 1941-1942 : "il faut que toute participation humaine à l'accomplissement du nouvel ordre porte en soi l'insigne de la totalité" [souligné par moi]. Heidegger mène très loin les idées de Nietzsche, profitant de leur nature antidémocratique. L'histoire devait cependant donner tort à Heidegger et à son exploitation philosophique du "nihilisme extrême". Il n'en reste pas moins que l'ordre démocratique qui s'installa après la guerre ne résolut pas entièrement la question ; et qu'il la laissa même en plan, dans une sorte d'ambiguïté fondamentale, qui fit que le nihilisme put encore avoir de beaux jours devant lui. Je préfère sans doute cette tranquillité imparfaite, toute nihiliste soit-elle. Elle n'interdit pas par exemple, quant à elle, le retour à quelques traditions anciennes, pour tenter d'apporter des réponses pacifiques au malaise qui continue. Le nihilisme n'a pas été qu'une crise passagère, la métaphysique elle-même en a été affectée, comme ont su le reconnaître Nietzsche, et Heidegger à sa suite. Mais le diagnostic seul était bon ; il reste toujours à l'homme la tâche si périlleuse de trouver les remèdes appropriés à ce mal profond, qui ne cesse pas. Enjeu très incertain, comme je le pense, face au monde moderne.
Illustration : photographie de Nietzsche
11:46 Publié dans Philosophie | Tags : nietzsche, heidegger, platon, la mort de dieu, histoire, valeurs, civilisation occidentale, nihilisme, nazisme, troisième reich, démocratie, nihilisme extrême, traditions, métaphysique, monde moderne | Lien permanent | Commentaires (0)
30/01/2015
L'Etat, le terrorisme et la démocratie

Dans des réflexions que j'ai pu lire dans les journaux ou sur des blogs, à propos des événements terroristes de ce mois de janvier en France, il m' a semblé voir apparaître un sentiment de grande ambiguïté et de trouble vis-à-vis du rôle même de l'État. D'une part, les citoyens ont ressenti assez justement l'atteinte portée symboliquement à l'unité nationale, mais d'autre part ils ont accueilli le rôle que se sont octroyé leurs représentants politiques avec la plus grande réserve, en les voyant se jeter sur ce prétexte tragique pour renforcer tout un arsenal de lois répressives. A tel point, dans ce contexte, que la fameuse loi Macron, discutée au Parlement, a dû être amputée de dispositions particulièrement liberticides, qui faisaient scandale dans les gazettes et les écoles de journalisme.
Je me demandais ces jours-ci ce qu'un penseur comme Guy Debord aurait dit du terrorisme islamiste contemporain. Relisant certains passages de ses livres, je vérifiais qu'il n'aurait pas eu à ajouter grand-chose à ce qu'il avait écrit, par exemple en 1988 dans ses Commentaires sur la Société du Spectacle. Je vais vous citer le passage, mais en précisant tout de suite qu'il ne faut pas interpréter le propos de Debord comme une énième répétition de la théorie du complot. Il n'aurait évidemment jamais prétendu que c'est l'État qui a organisé le massacre parisien du début janvier. Sa pensée est beaucoup plus fine, et trouve d'ailleurs un écho insolite parmi beaucoup de commentateurs actuels (par exemple sur le site Mediapart). Voici le passage en question :
"Cette démocratie si parfaite fabrique elle-même son incroyable ennemi, le terrorisme. Elle veut, en effet, être jugée sur ses ennemis plutôt que sur ses résultats [souligné par Debord]. L'histoire du terrorisme est écrite par l' État ; elle est donc éducative. Les populations spectatrices ne peuvent certes pas tout savoir du terrorisme, mais elles peuvent toujours en savoir assez pour être persuadées que, par rapport à ce terrorisme, tout le reste devra leur sembler plutôt acceptable, en tout cas plus rationnel et plus démocratique." (Chapitre IX)
Dans un même mouvement, c'était la question centrale de la démocratie qui se trouvait ainsi posée, et je crois que c'est encore ainsi qu'elle se pose aujourd'hui, comme une éternelle quadrature du cercle, si souvent pour le malheur des populations. Debord devait constater à ce sujet, dans un livre de 1993, sans du reste beaucoup s'étendre sur une question qui lui semblait désormais assez vaine : "Tocqueville ne garantissait pas, de son vivant, que la liberté aurait réellement sa place dans les futures sociétés libérales." L'assertion était hélas sans réplique ; avait-il tort en cela ?
Quand il m'arrive parfois — à vrai dire assez rarement — de parler à des jeunes de la pensée de Debord, et même de celle de Baudrillard (qui lui doit tant), je rencontre chez mes interlocuteurs une sorte d'indifférence latente. Le seul résultat que j'en retire, est qu'ils me prennent pour un vieux réactionnaire de droite, nostalgique d'un passé révolu. Telle est donc la postérité de cette pensée situationniste, jadis fleuron de l'avant-garde et de la pensée d'extrême gauche. Elle a changé de lieu.
Illustration : image du film de Debord, In girum imus nocte et consumimur igni (1978)
11:22 Publié dans Actualité | Tags : l'état, terrorisme, démocratie, unité nationale, loi macron, répression, guy debord, islamisme, commentaires sur la société du spectacle, théorie du complot, site mediapart, tocqueville, sociétés libérales, baudrillard, in girum imus nocte et consumimur igni | Lien permanent | Commentaires (2)
