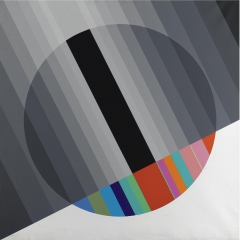21/07/2021
De la répétition à la (re)prise
La collection « Folio » à 2 € propose des textes assez courts à un prix défiant toute concurrence. Ce sont des livres parfaits à emporter en vacances, et à lire dans le calme d’une villégiature paradisiaque. Vous avez par exemple Les Affamés ne rêvent que de pain, d’Albert Cossery, ou encore, plus récemment, Bruges-la-Morte de Georges Rodenbach. Cet été, la collection propose un récit de vacances, mais qui est bien plus que cela, sans doute, La Plage de Cesare Pavese, un court roman datant des années 40, et qui fut publié en France une première fois dans un volume regroupant deux autres textes mémorables.
Une double compulsion de répétititon
Dans La Plage, il y a un narrateur qui est turinois, comme Pavese. Il est invité en vacances sur la Riviera ligure, à proximité de Gênes, par un ami d’enfance, Doro, marié avec une Génoise, Clelia. Ces deux-là forment un couple très amoureux, que le narrateur, personnage d’un tempérament jaloux, aimerait troubler, voire monter l’un contre l’autre. À observer, dans l’ennui et la chaleur étouffante de l’été, Doro et Clelia évoluer néanmoins dans le bonheur d’un couple bien assorti, le narrateur éprouve du ressentiment, d’autant qu’il se laisse aller à être amoureux secrètement de Clelia.
Le récit de Pavese est construit sur un double motif de compulsion. En premier lieu, je viens d’y faire allusion, le narrateur voudrait à toute force que Doro et Clelia se soient querellés. À plusieurs reprises, il revient sur ce sujet, tour à tour avec Doro, puis avec Clelia. À chaque fois, il est calmement contredit. Cela donne par exemple le dialogue suivant, dans lequel le narrateur en devient littéralement impoli, grossier : « Vous n’êtes donc pas en froid ? […] Comment se fait-il alors, dis-je, que, de temps en temps, Clelia te cherche avec des yeux épouvantés, tel un chien ? Elle a tout à fait l’air d’une femme qui aurait été battue. Tu l’as battue ? » Évidemment, il n’en est rien. Le couple s’entend toujours à merveille.
Le deuxième motif de compulsion est amené de manière plus discrète. Il s’agit de la grossesse de Clelia, qui se révèle à la dernière page du récit, et déterminera le retour à Gênes du couple, et donc la fin des vacances pour le narrateur. Tout se passe comme si le narrateur ignorait de facto l’état de Clelia, et pourtant sa maternité éventuelle est évoquée en quelques endroits du roman par différents amis qui évoluent autour du couple et du narrateur. Celui-ci relate, entre autres, le dialogue suivant : « Mais le but n’est pas simplement la famille, dit Doro. C’est de préparer le climat d’une famille. ‒ Mieux vaut un enfant sans climat, qu’un climat sans enfants, décréta Ginetta. » Les allusions à un enfant à naître se multiplient, par conséquent, et le narrateur les retranscrit, sans se douter que c’est ce qui va arriver.
Le narrateur de Pavese, qui doit certainement beaucoup à Pavese lui-même, se présente aux lecteurs d’une manière paradoxale, plutôt négative, en fait. « J’avais le sentiment d’être un intrus, un incapable », dira-t-il au début. C’est un célibataire que la vie a déjà rendu amer. Cette manière, pour un écrivain, de faire de soi, en quelque sorte, un portrait à charge est souvent une grande marque de génie. On retrouve dans La Plage certains échos autobiographiques, qui rappellent Le métier de vivre, ce très grand texte de Pavese, dans lequel il a voulu s’exprimer avec une sincérité absolue ‒ juste avant son suicide. Pour Pavese, écrire était le défi ultime, le moment de vérité.
Un scénario qui se répète
Dans l’excellent et tout récent film portugais Journal de Tûoa, de Miguel Gomes et Maureen Fazendeiro, il y a une scène particulièrement belle de mise en abyme, au cours de laquelle l’écrivain Pavese est convoqué à brûle-pourpoint. Les deux metteurs en scène, alors que leurs acteurs sont en train de jouer, se lèvent et vont un peu à l’écart, au fond du jardin, afin d’évoquer ensemble les plans suivants. Et c’est à ce moment que Maureen Fazeindero se met à parler de Pavese, d’une manière délicate et subtile, qui apporte à cet instant une grâce inattendue.
J’ai toujours entre les mains le programme de ce film. Au lieu d’en faire un résumé improbable, les deux cinéastes ont choisi de partager, pour tout commentaire, une longue citation d’un roman de Pavese, non pas tiré de La Plage, mais du Diable dans les collines. Ce qui donnait : « L’orchestre reprit mais cette fois sans voix. Les autres instruments se turent et il ne resta que le piano qui exécuta quelques minutes de variations acrobatiques sensationnelles. Même si on ne le voulait pas, on écoutait. Puis l’orchestre couvrit le piano et l’engloutit. Pendant ce numéro, les lampes et les réflecteurs, qui éclairaient les arbres, changèrent magiquement de couleur, et nous fûmes tour à tour verts, rouges, jaunes. »
Si vous allez voir Journal de Tûoa, vous constaterez des répétitions volontaires dans le scénario et des prises rejouées presque à l’identique. Cela crée un effet mystérieux, très expérimental, qui n’est pas sans rapport avec le charme profond, mais parfois énigmatique, que cette œuvre procure.
Répétition et (re)prise
Le grand psychanalyste Pierre Kaufmann se demandait si la répétition était possible. Il ajoutait : « Même à répéter le même, le même, d’être répété, s’inscrit comme distinct. Voilà pourquoi Lacan signale que l’essence du signifiant c’est la différence. »
Dans une passionnante contribution parue dans un ouvrage intitulé La Prise au départ du cinéma, la critique et enseignante Sarah Ohana s’interroge sur la « mélancolie du geste de (re)prise ». En prenant comme objets d’étude trois grands films classiques d’Antonioni, Coppola et De Palma, elle s’interroge sur la répétition ou la « (re)prise » comme « geste d’introspection et de ressassement mélancolique ». À ce titre, on comprend bien que la répétition nous met au cœur du processus artistique. C’est d’abord un sentiment de mal-être, que rien a priori ne peut résoudre. Ici, on se heurte toujours aux mêmes obstacles, on ne trouve pas de porte de sortie. Sarah Ohana examine ainsi dans le film de Coppola, Conversation secrète, comment le cinéaste « choisit de retirer toute la matière de l’événement […] pour ne retenir qu’un geste obsessionnel ». Du coup, poursuit Sarah Ohana, « il semble qu’une temporalité purement mélancolique se crée ». C’est ce qu’on appelle « ressassement » : « le ressassement permet de se projeter éternellement dans le passé provoquant ainsi une boucle temporelle qui supprime toute possibilité d’avenir ». D’où un sentiment très fort d’angoisse.
Sarah Ohana s’en tient là de sa démonstration, même si le terme de « (re)prise » qu’elle utilise laisse comprendre que la pensée de Kierkegaard ne lui est pas du tout étrangère. Ce concept, on le sait, est en effet le titre d’un des livres les plus connus du penseur danois. Chrétien, il tentait de dépasser la simple répétition névrotique, qui devait lui être familière, pour la faire évoluer vers une renaissance spirituelle rédemptrice. La « reprise » était au départ plus spécifiquement pour Kierkegaard la proposition faite à sa fiancée Régine Olsen de renouer des liens avec lui. Cela est devenu sous sa plume une sorte d’idéal humain, une recherche de la lumière.
Le texte suivant de Kierkegaard, que j’ai trouvé dans la notice de l’édition de la Pléiade de La Reprise, en offre une remarquable explication. Il vaut d’être cité en entier : « Dans la réalité en tant que telle, il n’y a pas de reprise. Cela ne vient pas du fait que tout est différent, nullement. Si tout au monde était absolument identique, dans la réalité il n’y aurait pas de reprise, parce que celle-ci n’existe que dans le moment. Même si le monde, au lieu d’être beauté, n’était fait que de purs blocs de granit uniformes, il n’y aurait pas de reprise. Je verrais de toute éternité en chaque moment un bloc de granit, mais que ce fût le même que celui que j’avais vu précédemment, cela ne ferait aucun doute. Seulement, dans l’idéalité il n’y a pas de reprise ; car l’idée est et reste la même et elle ne peut être reprise en tant que telle. Quand l’idéalité et la réalité entrent en contact, alors surgit la reprise. »
Un autre fragment, toujours dans la Pléiade, résumait ainsi la chose : « la reprise est dans le règne de l’esprit ». À partir de là, il est vrai, un autre chemin commence, qui passe par la foi.
Cesare Pavese, La Plage. Traduit de l’italien par Michel Arnaud, révisé par Muriel Gallot. « Folio » à 2 €.
La Prise au départ du cinéma. Sous la direction de Nathalie Mauffrey et Sarah Ohana. Éd. Mimésis, 24 €.
02/07/2021
Jean-Marie Rouart, à la recherche de nos valeurs perdues
Jean-Marie Rouart n’est pas seulement le romancier que l’on connaît : c’est aussi un commentateur très libre de la vie du monde, dont les analyses paraissent soit dans la presse, soit dans des ouvrages souvent inspirés, qui remuent ses lecteurs de droite, et, peut-être, de gauche. Le sujet qu’il traite dans ce nouvel essai, Ce pays des hommes sans Dieu, au titre qui dit tout, réunira sans doute les uns et les autres, tant le thème en est pressant, dramatique, poignant. Il s’agit en effet pour Jean-Marie Rouart de se demander si l’héritage chrétien de la France est en train de sombrer ou non, et d’évaluer une possible concurrence avec l’islam, qui a le vent en poupe.
Jean-Marie Rouart commence par nous expliquer d’où il parle. Il évoque son éducation chrétienne, se souvient des cérémonies religieuses dans son enfance qui nourrissaient tant son imagination. S’il perd la foi assez tôt, il convient qu’il a été marqué par cette tradition, et qu’il a probablement cherché dans l’art une compensation : « La pratique de l’art, écrit-il, m’apparut comme le canal de dérivation d’une foi perdue. »
Il ne peut s’empêcher d’être malheureux, aujourd’hui, lorsqu’il voit la religion de son enfance disparaître peu à peu, au profit d’un islam conquérant en pleine effervescence. Car si Rouart admire en connaisseur la religion catholique, cela ne l’empêche pas d’admettre que l’islam possède une très haute « spiritualité », « dont la part la plus connue, précise-t-il, est le soufisme ». Et Rouart de nous citer les représentants français les plus admirables des études islamiques, comme Louis Massignon ou René Guénon.
Ce n’est pas pour autant, bien entendu, qu’il faut abandonner à sa décadence la civilisation occidentale. Jean-Marie Rouart, inspiré par Renan, qu’il cite longuement, se dresse en défenseur tolérant mais vigoureux des valeurs chrétiennes de la France. « Ce qui me désole, note-t-il, c’est notre peu d’attachement à ce socle fondateur dont la disparition progressive risque d’ouvrir la porte à une autre aventure moins riche et moins glorieuse. Ou qui sait à l’islam ? » Voici donc Jean-Marie Rouart qui regarde du côté de Houellebecq, celui de Soumission. Ceci me semble très significatif.
Pour donner du recul à sa réflexion, Jean-Marie Rouart revient sur les grandes articulations de notre histoire nationale, du baptême de Clovis jusqu’au Concordat, de la Révolution jusqu’à la loi sur la laïcité de 1905. Rouart note d’ailleurs qu’il serait favorable à un nouveau concordat, comme celui de 1801 ‒ et ce n’est pas seulement sa passion pour Napoléon qui l’y incite. Il s’arrête également sur le Concile Vatican II, dont de Gaulle avait dit à Jean Guitton, nous apprend Rouart, qu’il était « l’événement majeur du XXe siècle ». Le moins qu’on puisse dire est que Jean-Marie Rouart estime désastreuses les conséquences du Concile : « Le merveilleux chrétien s’estompe au profit d’un prosaïsme religieux et d’une austérité qui ôte la soutane aux prêtres pour qu’ils ne soient pas trop différents des autres hommes. » Il cite aussi le mot définitif de l’écrivain Julien Green, dans son Journal, qui affirmait : « l’Église romaine est devenue protestante ».
Cette condamnation discutable et discutée du Concile Vatican II par Jean-Marie Rouart est un point qui mérite qu’on s’y attarde brièvement. Pour dire d’abord que cette « révolution » dans l’Église a été déclenchée, avant tout, à cause d’un déclin qui se profilait déjà dans les années soixante. Il fallait absolument tenter quelque chose. Vatican II a apporté une modernisation appréciable, même si elle n’est pas parfaite, reléguant aux oubliettes de l’histoire tous les excès dont la religion catholique s’était rendue coupable au fil des siècles. Vatican II a joué sur le long terme, et permis, du moins en théorie, le retour des fidèles dans le giron de l’Église. Et j’ajouterai que, désormais, depuis un motu proprio du pape Benoît XVI daté du 7 juillet 2007, il est loisible à nouveau, pour ceux qui le désirent, d’assister à la messe en latin en « la forme extraordinaire du rite romain ».
Là où, en revanche, Jean-Marie Rouart a bien raison d’insister, c’est sur la nécessité d’une reconstruction, qui nous demandera beaucoup de courage. « La solution, écrit-il en conclusion de son ouvrage, nous ne pouvons la trouver qu’en nous-mêmes. Dans cet héritage religieux et culturel qui a assuré notre force. C’est ce legs qui est menacé. » Jean-Marie Rouart, et il ne pouvait certes nous décevoir là-dessus, avance qu’un des « piliers de la nation française », c’est sa littérature, « le lien qui relie les Français entre eux ». En quelques pages particulièrement pertinentes, il nous dresse un constat de la situation, très alarmant ; là aussi, il faudra faire bien des efforts !
Jean-Marie Rouart, dans ce livre au cœur du débat, tisse une réflexion d’essayiste, mais en même temps, puisqu’il est romancier, une méditation littéraire, sur des questions qui ont acquis une importance vertigineuse, et dont la plus redoutable est sans aucun doute celle-ci : allons-nous pouvoir continuer à être des Français ? Ce pays des hommes sans Dieu apporte une contribution originale au débat actuel, dans le contexte très politique de la loi sur la séparation voulue par le président Macron.
Jean-Marie Rouart, Ce pays des hommes sans Dieu. Éd. Bouquins, 19 €.
10:17 Publié dans Livre | Tags : jean-marie rouart, héritage chrétien, foi, rené guénon, renan, spiritualité, houellebecq, clovis, vatican ii, littérature, loi sur la séparation, religion, france, civilisation | Lien permanent | Commentaires (0)
23/02/2016
La planète cathodique
C'est à l'occasion d'un colloque tenu à Paris en 1997, et consacré très précisément à "Religion et média", que Jacques Derrida fit la communication qui est reprise dans ce bref volume sous le titre Surtout, pas de journalistes ! Le propos, improvisé, de Derrida consiste ici en une introduction générale, suivie de ses réponses à quelques questions de la salle. Le thème était vaste, et le philosophe n'en a pas esquivé la problématique, renvoyant en divers endroits à son ouvrage Foi et Savoir (le Seuil, 1996). Ce qui a retenu mon attention en premier lieu, dans ces quelques pages, c'est la manière dont Derrida aborde la religion, à travers l'exemple biblique bien connu d'Abraham à qui Dieu demande de sacrifier son fils unique. "Qu'est-ce que Dieu, s'interroge Derrida, a dû dire à Abraham ?" Or, cela, nous ne le savons pas, car l'événement n'a pas été médiatisé. Tout est resté secret. Et c'est ce secret, selon Derrida, qui fait l'essence même des religions juive et musulmane, par opposition au christianisme (le Christ, rappelle Derrida, "aura été le premier journaliste ou nouvelliste, comme les évangélistes qui rapportent la bonne nouvelle"). Ainsi, la comparaison entre la propagation actuelle de l'information à l'échelle de la planète et le surgissement d'une religion médiatisée comme le christianisme apparaît à Derrida comme un point crucial : "Au cours d'une messe chrétienne, écrit-il, la chose même, l'événement se passe devant la caméra..." La "venue de la présence réelle" se produit en direct. La retransmission par les caméras de télévision vient d'ailleurs renforcer cet effet de réel religieux si spécifique. Médias et religion décuplent ici leurs forces spectaculaires. Derrida est bien sûr trop intelligent pour s'arrêter là. Néanmoins, il use d'un tel dispositif sans vraiment mettre en question, me semble-t-il, une vision plus complexe de la religion chrétienne. Sauf à un moment, où il est amené à parler de la foi, et à se demander quelle importance elle acquiert en philosophie (en philosophie plutôt que dans la religion). Derrida écrit en effet : "Que veut dire croire à la foi ?" Nous arrivons ici au cœur du problème. Derrida va conserver une "équivoque" certaine face à cette formulation cruciale de la foi : "C'est parce que je crois que l'équivoque est indéniablement là. Nous sommes, je suis [Derrida emploie la première personne du singulier, pour bien montrer qu'il s'agit avant tout de son cas personnel à lui] dans l'équivoque." La religion, pour Derrida, possède un "rapport équivoque à la foi", et on sent donc très bien, à ce stade, ce qui empêche le philosophe d'avancer plus avant dans la comparaison religion/média. Ce n'est pas le moindre intérêt de cette petite conférence de nous faire toucher du doigt une aporie discursive, qui nous fait sortir de la philosophie et accéder au cas propre du penseur qui se met en jeu ici et maintenant.
Jacques Derrida, Surtout, pas de journalistes ! Éd. Galilée, 17 €.
Illustration : Eugenio Carmi
16:46 Publié dans Philosophie | Tags : jacques derrida, surtout, pas de journalistes !, religion, médias, abraham, christianisme, islam, religion juive, télévision, foi, croire, philosophie | Lien permanent | Commentaires (0)