02/07/2021
Jean-Marie Rouart, à la recherche de nos valeurs perdues
Jean-Marie Rouart n’est pas seulement le romancier que l’on connaît : c’est aussi un commentateur très libre de la vie du monde, dont les analyses paraissent soit dans la presse, soit dans des ouvrages souvent inspirés, qui remuent ses lecteurs de droite, et, peut-être, de gauche. Le sujet qu’il traite dans ce nouvel essai, Ce pays des hommes sans Dieu, au titre qui dit tout, réunira sans doute les uns et les autres, tant le thème en est pressant, dramatique, poignant. Il s’agit en effet pour Jean-Marie Rouart de se demander si l’héritage chrétien de la France est en train de sombrer ou non, et d’évaluer une possible concurrence avec l’islam, qui a le vent en poupe.
Jean-Marie Rouart commence par nous expliquer d’où il parle. Il évoque son éducation chrétienne, se souvient des cérémonies religieuses dans son enfance qui nourrissaient tant son imagination. S’il perd la foi assez tôt, il convient qu’il a été marqué par cette tradition, et qu’il a probablement cherché dans l’art une compensation : « La pratique de l’art, écrit-il, m’apparut comme le canal de dérivation d’une foi perdue. »
Il ne peut s’empêcher d’être malheureux, aujourd’hui, lorsqu’il voit la religion de son enfance disparaître peu à peu, au profit d’un islam conquérant en pleine effervescence. Car si Rouart admire en connaisseur la religion catholique, cela ne l’empêche pas d’admettre que l’islam possède une très haute « spiritualité », « dont la part la plus connue, précise-t-il, est le soufisme ». Et Rouart de nous citer les représentants français les plus admirables des études islamiques, comme Louis Massignon ou René Guénon.
Ce n’est pas pour autant, bien entendu, qu’il faut abandonner à sa décadence la civilisation occidentale. Jean-Marie Rouart, inspiré par Renan, qu’il cite longuement, se dresse en défenseur tolérant mais vigoureux des valeurs chrétiennes de la France. « Ce qui me désole, note-t-il, c’est notre peu d’attachement à ce socle fondateur dont la disparition progressive risque d’ouvrir la porte à une autre aventure moins riche et moins glorieuse. Ou qui sait à l’islam ? » Voici donc Jean-Marie Rouart qui regarde du côté de Houellebecq, celui de Soumission. Ceci me semble très significatif.
Pour donner du recul à sa réflexion, Jean-Marie Rouart revient sur les grandes articulations de notre histoire nationale, du baptême de Clovis jusqu’au Concordat, de la Révolution jusqu’à la loi sur la laïcité de 1905. Rouart note d’ailleurs qu’il serait favorable à un nouveau concordat, comme celui de 1801 ‒ et ce n’est pas seulement sa passion pour Napoléon qui l’y incite. Il s’arrête également sur le Concile Vatican II, dont de Gaulle avait dit à Jean Guitton, nous apprend Rouart, qu’il était « l’événement majeur du XXe siècle ». Le moins qu’on puisse dire est que Jean-Marie Rouart estime désastreuses les conséquences du Concile : « Le merveilleux chrétien s’estompe au profit d’un prosaïsme religieux et d’une austérité qui ôte la soutane aux prêtres pour qu’ils ne soient pas trop différents des autres hommes. » Il cite aussi le mot définitif de l’écrivain Julien Green, dans son Journal, qui affirmait : « l’Église romaine est devenue protestante ».
Cette condamnation discutable et discutée du Concile Vatican II par Jean-Marie Rouart est un point qui mérite qu’on s’y attarde brièvement. Pour dire d’abord que cette « révolution » dans l’Église a été déclenchée, avant tout, à cause d’un déclin qui se profilait déjà dans les années soixante. Il fallait absolument tenter quelque chose. Vatican II a apporté une modernisation appréciable, même si elle n’est pas parfaite, reléguant aux oubliettes de l’histoire tous les excès dont la religion catholique s’était rendue coupable au fil des siècles. Vatican II a joué sur le long terme, et permis, du moins en théorie, le retour des fidèles dans le giron de l’Église. Et j’ajouterai que, désormais, depuis un motu proprio du pape Benoît XVI daté du 7 juillet 2007, il est loisible à nouveau, pour ceux qui le désirent, d’assister à la messe en latin en « la forme extraordinaire du rite romain ».
Là où, en revanche, Jean-Marie Rouart a bien raison d’insister, c’est sur la nécessité d’une reconstruction, qui nous demandera beaucoup de courage. « La solution, écrit-il en conclusion de son ouvrage, nous ne pouvons la trouver qu’en nous-mêmes. Dans cet héritage religieux et culturel qui a assuré notre force. C’est ce legs qui est menacé. » Jean-Marie Rouart, et il ne pouvait certes nous décevoir là-dessus, avance qu’un des « piliers de la nation française », c’est sa littérature, « le lien qui relie les Français entre eux ». En quelques pages particulièrement pertinentes, il nous dresse un constat de la situation, très alarmant ; là aussi, il faudra faire bien des efforts !
Jean-Marie Rouart, dans ce livre au cœur du débat, tisse une réflexion d’essayiste, mais en même temps, puisqu’il est romancier, une méditation littéraire, sur des questions qui ont acquis une importance vertigineuse, et dont la plus redoutable est sans aucun doute celle-ci : allons-nous pouvoir continuer à être des Français ? Ce pays des hommes sans Dieu apporte une contribution originale au débat actuel, dans le contexte très politique de la loi sur la séparation voulue par le président Macron.
Jean-Marie Rouart, Ce pays des hommes sans Dieu. Éd. Bouquins, 19 €.
10:17 Publié dans Livre | Tags : jean-marie rouart, héritage chrétien, foi, rené guénon, renan, spiritualité, houellebecq, clovis, vatican ii, littérature, loi sur la séparation, religion, france, civilisation | Lien permanent | Commentaires (0)
04/11/2014
Refus d'agir
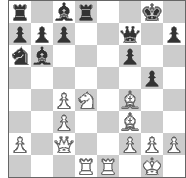
Je joue parfois aux échecs en ligne, c'est-à-dire contre une intelligence artificielle. Chaque fois, je suis étonné d'être confronté à un adversaire redoutable et particulièrement coriace. Lorsque je choisis le niveau le plus fort, j'ai en face de moi quelque chose de féroce et de cynique à la fois, qui ne laisse rien passer, inhumain jusqu'à me paraître monstrueux. Dans 2001, l'Odyssée de l'espace, Stanley Kubrick avait bien montré toute cette perversité intrinsèque du robot, qui portait à un stade ultime une sorte de machiavélisme sadique. C'est d'ailleurs sans doute, dans l'avenir, ce qui nous pend magnifiquement au nez. Par esprit de contradiction, j'ai parfois tenté l'expérience suivante, lors de parties en ligne : au lieu de jouer des coups véritablement offensifs, pour tenter de gagner, je me suis contenté de faire du surplace, par exemple en avançant et reculant alternativement une pièce comme la tour ou le cavalier. Au début, cet immobilisme systématique a dérouté quelque peu l'ordinateur. Mais il a vite compris l'astuce ! Il s'est mis à redoubler d'agressivité, et m'a fait échec et mat à une vitesse fulgurante. Outre d'avoir été battu à plate couture, j'en ai tiré une leçon générale assez déprimante : dans ce monde ici-bas, tout est fait et organisé pour l'action efficace, rien pour l'abstention. C'est vrai pour la partie d'échecs programmée, ce l'est encore plus pour la vie elle-même dans sa globalité. L'inertie est hors jeu, la non-participation interdite sous peine de fin de partie instantanée. Pascal, inventeur comme on sait de la "machine arithmétique", l'avait lui-même parfaitement compris, qui écrivait par exemple dans sa Pensée n° 129 : "Notre nature est dans le mouvement ; le repos entier est la mort." Si la civilisation de l'ordinateur a réussi à s'imposer avec autant de succès parmi nous, c'est, je crois, parce que l'intelligence artificielle réalise presque parfaitement cet idéal d'élan vital qu'une nature probablement dévoyée a créé en l'homme. Le malheureux qui chercherait le repos dans la non-action apprend bien vite que, ce faisant, il se condamne hic et nunc.
16:33 Publié dans Philosophie | Tags : échecs, intelligence artificielle, 2001 l'odyssée de l'espace, stanley kubrick, robot, machiavélisme, surplace, immobilisme, ordinateur, échec et mat, action, abstention, vie, pascal, pensée n° 129, mouvement, mort, civilisation, idéal, élan vital, non-action, repos, fin de partie, machine arithmétique | Lien permanent | Commentaires (0)
28/10/2014
Aristote et la question de l'oisiveté

Il faudrait relire ce qu'écrivait le père Rapin, au XVIIe siècle, à propos de la réception en Europe de la pensée d'Aristote, son passage notamment chez les philosophes arabes, son éclosion à l'époque de saint Thomas d'Aquin parmi les savants : on aurait alors une idée assez exacte de l'importance du Stagirite à travers l'histoire comme fondement principal de la philosophie. Alors que paraissent deux recueils de ses œuvres complètes, l'un en Pléiade avec de nouvelles traductions, l'autre chez Flammarion, c'est le moment de s'interroger sur une question à mes yeux essentielle posée par Aristote dans son Éthique de Nicomaque : la question du "propre" de l'homme dans ses relations avec le désœuvrement.
Aristote se demandait, à propos du bonheur, ce qui caractérisait avant tout l'homme, et si plus particulièrement "la nature aurait fait de celui-ci un oisif ?" (Éthique de Nicomaque, I, VII, 11). Le recours au concept d'oisiveté remet les choses bien à plat, et c'est sans doute pourquoi ce passage frappe autant certains commentateurs (dont par exemple le philosophe Giorgio Agamben). On voit très bien en effet que la pensée qui se déploie ici trouve son fondement dans ce qui en manque terriblement. Le paradoxe veut que c'est pour cette raison qu'elle sera si efficace. Le désœuvrement pousse la question dans ses derniers retranchements : de cette surface indéterminée naît ce qui fait le propre de l'homme. La réponse, inscrite dans le droit fil de cette Éthique de Nicomaque, nous ramène vers "l'activité de l'âme", et sa propension au Bien et au Beau. Rappelons que le propos d'Aristote est de nous parler du bonheur. C'est un "métier" d'être heureux, une occupation constante de notre âme qui, travaillant à la Vertu, permet à l'homme désœuvré de contempler le cosmos. Il y a peut-être une réserve à apporter à ce si parfait scénario, et c'est Aristote lui-même qui l'évoque dans l'un des derniers chapitres : "Une telle existence, toutefois, pourrait être au-dessus de la condition humaine." (X, VII, 8) Ce qu'Aristote croyait encore possible, devenir des dieux, ne l'est plus, après seulement quelque deux millénaires de civilisation. L'histoire nous a montré quels périls étaient attachés à cette présomption. Le "travail" intime en vue d'une Vertu supérieure a été mis à mal par une nécessité pour l'homme de songer d'abord à survivre au rythme des révolutions dans le temps. Aujourd'hui, il est de fait presque interdit à l'être humain de prendre le loisir de penser à son âme, en tout cas de se tourner, même brièvement, vers un tel processus de désœuvrement ou d'oisiveté. Quand nous lisons désormais l'Éthique de Nicomaque, une immense nostalgie ne peut que nous saisir, et l'on se dit alors : tout aurait dû être si bien...
Parutions : Aristote, Œuvres complètes, sous la direction de Pierre Pellegrin. Éd. Flammarion, 69 €. Du même, Œuvres, sous la direction de Richard Bodéüs. Traductions nouvelles. Éd. Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 61 €.
J'ai utilisé dans la note ci-dessus la traduction de l'Éthique de Nicomaque de Jean Voilquin, éd. de poche GF Flammarion.
12:02 Publié dans Philosophie | Tags : aristote, père rapin, philosophes arabes, europe, thomas d'aquin, éthique de nicomaque, désoeuvrement, oisiveté, bonheur, giorgio agamben, âme, bien, beau, vertu, cosmos, contemplation, civilisation, histoire, survivre, nostalgie, oeuvres d'aristote, pléiade gallimard, flammarion | Lien permanent | Commentaires (0)
04/07/2014
Mélange des genres

Gustav Mahler racontait que, tout jeune, il avait assisté à une violente scène de ménage entre ses parents. Quittant précipitamment la maison, il se retrouva dans la rue où un orgue de Barbarie égrenait la chanson O, du lieber Augustin. C'était là pour le compositeur l'origine de cet entrelacs entre tragique et légèreté, frivolité et gravité, assez typique de sa musique. Explication très freudienne, trop peut-être, d'un trait de caractère qu'on retrouve chez maints artistes viennois de cette époque. Cet alliage sophistiqué entre les contraires a peut-être pris son plus vif essor alors, dans cette phase de décadence d'une civilisation excessivement raffinée, qui contemplait son déclin au milieu des dernières fêtes. Comment ne pas être admiratif de cet amalgame, jusqu'à traquer l'ironie parfois où elle n'est pas ? D'où nous vient, aujourd'hui même, ce goût, cette attirance paradoxale ? J'ai pour ce qui me concerne beau chercher, aucune anecdote ne remonte à la surface de ma mémoire pour dévoiler un aléatoire pourquoi. Ce fut plutôt une caractéristique globale de la société que nous avons traversée : l'indolence de plusieurs générations gavées de chansonnettes sans intérêt, et, le temps s'écoulant, le pessimisme noir, fruit des désillusions. Une certaine dérision n'est pas sans rapport, je pense, avec une situation de naufrage — d'agonie...
08:48 Publié dans Musique | Tags : gustav mahler, scène de ménage, orgue de barbarie, o du lieber augustin, tragique, légèreté, frivolité, gravité, musique, freud, vienne, décadence, civilisation, raffinement, déclin, dernières fêtes, ironie, société, indolence, générations, pessimisme, dérision, naufrage, agonie | Lien permanent | Commentaires (0)
11/03/2014
Nietzsche contre la morale

Nietzsche était un grand lecteur des moralistes français. Ils l'ont formé, ont nourri sa pensée. Bien sûr, au XXe siècle, on a retenu de sa philosophie surtout des concepts assénés "à coups de marteau". A côté de très belles pages, où tout son génie éclate, il y a aussi, malheureusement, des considérations plus discutables, moins convaincantes. Aussi bien, l'on ne devient pas l'un des plus grands défricheurs de la pensée sans se tromper un peu. Souvenons-nous en priorité du Nietzsche étincelant de certains aphorismes, qui a su réévaluer à lui tout seul l'héritage de la culture européenne et ouvrir jusqu'à aujourd'hui tant de chemins nouveaux, en particulier sur le chapitre de la morale.
Nietzsche reproche à la morale d'aller à l'encontre de la vie même, au nom de je ne sais quel vitalisme dont il ne démontre d'ailleurs jamais le bien-fondé. La morale réfrène les instincts primitifs, Nietzsche le déplore. Il ne veut apparemment pas d'un monde de douceur, il lui faut une réalité plus âpre, des dangers. Nietzsche admire la morale des "bandits corses". Il remet donc en question avec vigueur les valeurs de son époque. Il pense qu'on ne doit pas régler sa vie sur des mensonges — et en ce sens il est bien lui-même un moraliste, mais un moraliste qui quitte la morale. Suprême raffinement, mais qui interroge. Nietzsche a l'air tellement sûr qu'avant l'invention de la morale l'homme se trouvait dans une condition enviable ! Je ne le pense pas. La loi de la jungle devait être souvent bien cruelle, notamment pour les plus faibles. Une sélection fort inhumaine devait s'ensuivre : je n'aurais pas aimé être là pour le voir. L'un des points positifs de la morale, parmi sans doute bon nombre d'inconvénients, est par conséquent d'avoir tenté de rendre le monde vivable, peut-être d'une manière artificielle et assez peu authentique, mais qui somme toute valait mieux que la raison du plus fort. A l'homme désormais de réfléchir sur le sens qu'il veut donner à la morale, ce que Nietzsche lui-même semblait appeler de ses vœux, lorsqu'il prônait par exemple, dans l'aphorisme 335 du Gai Savoir, la nécessité de se créer un "idéal proprement personnel". N'est-ce pas ce qui a été rendu possible au terme de millénaires d'une évolution lente et paradoxale ? Au bout du compte, je crois que la philosophie de Nietzsche, à condition qu'on la critique, montrerait qu'un choix reste ouvert à l'être humain, à la société dans laquelle il vit, justement grâce au concept de civilisation, c'est-à-dire au fond grâce à ce qu'une morale, même "imaginaire", peut proposer, — de manière certes encore imparfaite et si pleine d'embûches...
12:00 Publié dans Philosophie | Tags : nietzsche, moralistes français, philosopher à coups de marteau, héritage de la culture européenne, la morale, vitalisme, instincts primitifs, morale de bandits corses, valeurs, loi de la jungle, la raison du plus fort, gai savoir, civilisation | Lien permanent | Commentaires (0)
