04/12/2023
Un film de Mona Achache
Généalogie d’une mère
Pour la cinéaste Mona Achache, tourner un film documentaire sur sa mère s’imposait, par une sorte de tradition familiale. Carole Achache avait déjà publié en 2011, quelques années avant son suicide, un livre de souvenirs, dont le titre, Fille de, faisait référence à sa propre mère, l’éditrice et romancière Monique Lange, grande amie de Jean Genet. Nous avons affaire ici, en comptant la petite-fille cinéaste, à une lignée de trois femmes, évoluant dans un creuset intellectuel juif particulièrement ouvert, et en évolution constante. C’est ce que montre, dans Little Girl Blue, Mona Achache, en centrant plus particulièrement son travail de reconstitution, autrement dit son droit d’inventaire, sur sa mère Carole. À vrai dire, il y a parfois une certaine confusion entre Monique, sa fille et la réalisatrice, car l’on saute d’une génération à l’autre comme si les trois femmes incarnaient un seul et même être protéiforme, une presque même vie, avec des orientations voisines, voire similaires.
Ressusciter Carole grâce à Marion Cotillard
Mona Achache a hérité de toutes les archives maternelles, qu’elle a installées dans un vaste appartement. Elle ne sait manifestement par où commencer, noyée au milieu des photos prises par sa mère, des livres, des lettres et autres documents. Elle a, pour tourner son documentaire, décidé de choisir l’actrice Marion Cotillard, qui incarnera sa mère à l’écran. Nous voyons, dès le début, Marion Cotillard arriver dans l’appartement, où Mona Achache la reçoit dans un silence sépulcral. Cotillard a l’air effarée, assommée par la tâche qui l’attend : ressusciter Carole. La caméra s’appesantit longuement sur la transformation en Carole de Marion Cotillard, à qui il suffit d’une perruque, d’une paire de lunettes et d’un collier pour figurer son personnage. On pourrait presque dire qu’il s’agit de « transformisme », tant le changement est impressionnant, pour ainsi dire à vue d’œil. Je me suis demandé s’il s’agissait ici d’obtenir une « reprise », au sens de Kierkegaard : « l’existence qui a été va exister », comme le philosophe danois définissait son concept majeur. De fait, Mona Achache est en quête de l’identité perdue de sa mère – et sans doute en même temps de la sienne propre. C’est une entreprise très sérieuse, quasi psychanalytique, qui aurait certainement plu à Jacques Lacan. Le cinéma et ses subterfuges permettront à Mona Achache de progresser de manière significative dans sa recherche. Pour rendre l’illusion encore plus parfaite, Marion Cotillard utilisera en outre sa voix, d’une ressemblance frappante avec celle de Carole. Ainsi, la scène où elle est allongée sur un lit et où elle prononce un long monologue, sans quasiment bouger, nous fait revivre, dans une sorte de plénitude tragique, la détresse de Carole, échouée à New York dans les années soixante-dix et obligée de se livrer à la prostitution. Plus tard, elle évoque la manière dont sa mère Monique Lange l’avait offerte à l’influence de Jean Genet, quand elle était toute petite et ressemblait, comme elle le précise avec un brin de perversité, à un petit Arabe. Au départ, raconte-t-elle, la morale par-delà bien et mal de l’auteur du Journal du voleur l’avait libérée, semble-t-il, avant de la perdre. D’autres souvenirs sont convoqués, repris, là encore, par exemple avec son beau-père l’écrivain Juan Goytisolo, lui aussi homosexuel. La mère Monique Lange et, par contrecoup, sa fille, Carole, ont subi une étrange attirance pour ces marginaux fascinants, qui évoluaient dans leur entourage et se jouaient facilement d’elles, les conduisant vers des chemins dangereux. Tout ceci a été méticuleusement archivé, et le documentaire de Mona Achache l’évoque de manière très exhaustive comme autant de pièces à conviction. L’interprétation de Marion Cotillard donne à cette psychanalyse sauvage une intensité extraordinaire, comme si Carole Achache était revenue là, assise devant sa fille Mona en pleurs, et s’expliquait enfin avec elle de vive voix et à tête reposée, en un face-à-face ultime de réconciliation.
Un questionnement infini
Malgré tout, Little Girl Blue s’achève, au générique, sur la chanson éponyme, interprétée par Janis Joplin, ce qui donne au film de Mona Achache une touche définitive de désespoir. Le suicide de sa mère reçoit-il une explication ? C’est un questionnement qui traverse le film de bout en bout, sans qu’une réponse catégorique ne soit apportée. Une sorte de découragement prend le dessus, face à cette complexité inextricable en quoi consiste le destin d’une femme, en l’occurrence celui quelque peu hors du commun de Carole Achache. La mise en scène de Mona Achache fait sentir cette difficulté, au milieu des échanges de paroles incessants. Le verbe ensevelit ces vies, comme toute vie, et c’est alors qu’il faut une reprise en main – si possible kierkegaardienne – grâce à un projet artistique comme celui de ce documentaire, avant-gardiste par nécessité. En ce sens, Little Girl Blue constitue, ne serait-ce que d’un point de vue purement formel, une réussite nécessaire. À voir et à revoir.
Little Girl Blue de Mona Achache (1 h 35). Avec Marion Cotillard. En salle actuellement.
Kierkegaard, La Reprise. Œuvres, tome 1. Traduction et présentation de Régis Boyer. « La Pléiade », éd. Gallimard, 2018.
04:51 Publié dans Film | Tags : mona achache, carole achache, monique lange, jean genet, goytisolo, kierkegaard, psychanalyse, suicide | Lien permanent | Commentaires (2)
21/06/2022
Le nouveau film d'Arnaud Desplechin
Le poème retrouvé d’Arnaud Desplechin
Les films d’Arnaud Desplechin ne me laissent jamais indifférent. J’ai particulièrement aimé son dernier, Frère et Sœur, avec Marion Cotillard et Melville Poupaud. La haine, mais aussi l’amour, son antithèse secrète, en sont les fils conducteurs. Desplechin filme cette histoire en lui laissant sa part d’improvisation, c’est-à-dire d’émotion, dans un style qui m’a rappelé La Règle du jeu de Renoir.
J’ai revu ce film, plus complexe qu’il n’y paraît, plusieurs fois. Le spectateur peut s’interroger sur les causes de la haine entre Louis, écrivain et poète, et sa sœur Alice, comédienne (elle joue dans une pièce tirée de The Dead de James Joyce). Desplechin est attiré par cette atmosphère littéraire, qu’incarnent ses deux personnages. Se détestent-ils autant chacun par jalousie du succès de l’autre ? Louis s’est inspiré de sa sœur dans l’un de ses livres, qu’elle est en train de lire alors qu’elle doit entrer en scène. Folle de rage, elle se frappe le visage et refuse de jouer. Mais l’hystérie est aussi du côté de Louis, comme une réaction presque naturelle. La mort de son fils Jacob a été pour lui un traumatisme définitif, qui a bouleversé ses relations avec sa famille. Son caractère de paria s’est creusé, malgré la présence attentive de sa très jolie femme.
Desplechin se garde bien d’apporter une explication. Il laisse seulement des indices, disséminés ici ou là. Avant qu’ils ne se détestent, Alice et Louis s’aimaient follement. Tous deux sont des êtres excessifs, qui vivent leurs passions avec une grande intensité. L’origine de leur brouille remonte à bien plus loin que la mort de Jacob. Sans doute à leur enfance ou à leur adolescence. Et un jour, alors que Louis reçoit un prix littéraire, sa sœur lui déclare, en riant à gorge déployée, qu’elle le hait.
Desplechin nous montre des scènes qui pourraient être des rêves ou des fantasmes. Ainsi quand Louis, sautant de son balcon, s’envole dans les airs et atterrit à l’hôpital dans le lit de sa mère. Dès lors, on ne sait plus très bien si ce qui arrive est réel ou bien une hallucination, d’autant plus que Louis consomme de l’opium. Tout ce flou est ce qui d’ailleurs permet au film d’acquérir une dimension psychanalytique assez évidente. Dès lors, il n’y aurait plus qu’à décrypter les sentiments grâce aux livres de Jacques Lacan, par exemple. Les références à la culture juive, dont Desplechin parsème son film, et dont il est un grand admirateur, vont peut-être dans ce sens.
Un des plus beaux passages de Frère et Sœur nous présente Louis accompagnant son meilleur ami, un psychiatre juif (joué par Patrick Timsit), à la synagogue pour la fête de Yom Kippour. C’est, on s’en souvient, le jour d’expiation des péchés, et Louis est vivement intéressé par ce qu’il entend. Il demande à son ami de lui traduire les paroles hébraïques prononcées par le rabbin. Or, en dressant l’oreille à cette scène, j’ai cru reconnaître la phrase suivante, tirée du Lévitique : « Tu ne découvriras pas la nudité de ta sœur, qu’elle soit fille de ton père ou fille de ta mère, qu’elle soit élevée à la maison ou au dehors. » Louis a l’air extrêmement touché par ces mots, comme si, justement, c’était ce qu’il avait à se reprocher avec sa propre sœur. Et un peu plus loin dans le film, pour aller encore dans le même sens, je note que Louis dit à Alice, lorsqu’ils se seront réconciliés : « Je pense à toutes ces années pendant lesquelles tu m’as laissé t’aimer. » Et que conclure d’une des dernières scènes, au cours de laquelle Louis et Alice se retrouvent nus dans le même lit ? Le message me semble clair, l’inceste est pointé du doigt ‒ sans nécessairement que cela soit très conscient chez Desplechin. Son film lui a peut-être échappé, en définitive.
Tout s’apaise, finalement. L’épilogue de Frère et Sœur est empreint d’espoir. Alice part se ressourcer en Afrique noire, et Louis reprend son travail de professeur à l’université. On le voit devant ses élèves, leur lisant un poème. Ce seront les ultimes paroles de Louis, dans le film de Desplechin. Il faut donc leur accorder l’importance qu’elles méritent. Je me suis renseigné. Il s’agit d’un extrait d’une œuvre du poète américain Peter Gizzi, né en 1959 dans le Michigan, lui-même professeur dans une université. Le titre en est : « Quelques valeurs du paysage et du temps » (en anglais Some values of lanscape and weather). Peter Gizzi y décrit tout ce qu’une génération a pu traverser et ressentir face à l’histoire, guerres comprises. C’est une poésie lyrique, très subjective, que je ne connaissais pas, et j’ai été frappé par la beauté des images. Au spectateur du film de Desplechin, maintenant, de réfléchir et de comprendre les rapports entre ce qu’il nous a raconté et ces quelques vers, que je vous cite à présent :
Où étions-nous
sur le ponton en train de fumer
après un jour au lit. Quelques orangés
et du velours bleu esquissent la forme des toits.
Ce n’est pas la première fois que ce sifflement nous arrête,
le train au crépuscule. Nous rappelant oum-pahs les appels
des cuivres bosselés autrefois sur la route :
de l’étoffe, des cheveux, et une corde pour nous guider.
Emmène-moi. Pour ne pas nier ces années
j’ai besoin de rester dans mon ornière
assez longtemps pour faire une embardée en dehors
de cette collision de particules qui gêne ma vue.
Je travaille d’arrache-pied pour renvoyer
d’autres palans de sauvetage ‒ quelque chose
de particulier au bleu a commencé
à remonter de la profondeur et à faire son schtick.
Et tombant dans la nuit, bien sûr
j’ai besoin de toi, mais cela dit
toutes les cordes lancées par-dessus bord
ne me trouveraient pas, comme le soleil autrefois
goutte à goutte dans le monde punk des sous-sols.
Le poème de Peter Gizzi, d’où est extrait ce passage, figure dans la brochure intitulée Revival, traduction de Pascal Poyet, éditions cipM/Spectres Familiers, collection « Le Refuge », 2003. Pour tout renseignement : CIPM Centre de la Vieille Charité 2, rue de la Charité 13002 Marseille (04 91 91 26 45). Il est possible de commander la brochure pour 10 €.
06:26 Publié dans Film | Tags : arnaud desplechin, "frère et soeur", james joyce, haine, rêves, fantasmes, psychanalyse, pensée juive, inceste, peter gizzi, poésie | Lien permanent | Commentaires (0)
13/04/2014
Le petit Marcellin
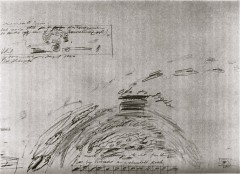
Dans La Nouvelle Héloïse, le dénouement tragique est provoqué par le fils de Julie. En tombant dans l'eau sous ses yeux (pour être sûr qu'elle le sauve ?), celui-ci devient la cause directe de la mort de sa mère. Certes, l'enfant ne l'a sans doute pas vraiment fait exprès, même si la psychanalyse nous dirait que quelque pulsion inconsciente, propre aux relations mère-fils, a pu se trouver à l'origine de l'accident. On peut aussi imaginer que, par la suite, la vie entière du petit garçon sera tourmentée par cet événement traumatisant, fondateur pour lui. Il se sentira éternellement coupable, et même se considérera quasiment comme le meurtrier de sa mère : je crois que, s'il avait écrit ce roman à notre époque, Rousseau aurait sans doute insisté sur cet aspect souterrain de l'âme enfantine, et décrit en détail les affres du petit Marcellin.
Illustration : Cy Twombly
06:13 Publié dans Livre | Tags : la nouvelle héloïse, rousseau, roman, julie, mère, relations mère-fils, mort, psychanalyse, pulsion inconsciente, traumatisme, culpabilité, meurtrier, âme enfantine, affres | Lien permanent | Commentaires (0)
