21/06/2022
Le nouveau film d'Arnaud Desplechin
Le poème retrouvé d’Arnaud Desplechin
Les films d’Arnaud Desplechin ne me laissent jamais indifférent. J’ai particulièrement aimé son dernier, Frère et Sœur, avec Marion Cotillard et Melville Poupaud. La haine, mais aussi l’amour, son antithèse secrète, en sont les fils conducteurs. Desplechin filme cette histoire en lui laissant sa part d’improvisation, c’est-à-dire d’émotion, dans un style qui m’a rappelé La Règle du jeu de Renoir.
J’ai revu ce film, plus complexe qu’il n’y paraît, plusieurs fois. Le spectateur peut s’interroger sur les causes de la haine entre Louis, écrivain et poète, et sa sœur Alice, comédienne (elle joue dans une pièce tirée de The Dead de James Joyce). Desplechin est attiré par cette atmosphère littéraire, qu’incarnent ses deux personnages. Se détestent-ils autant chacun par jalousie du succès de l’autre ? Louis s’est inspiré de sa sœur dans l’un de ses livres, qu’elle est en train de lire alors qu’elle doit entrer en scène. Folle de rage, elle se frappe le visage et refuse de jouer. Mais l’hystérie est aussi du côté de Louis, comme une réaction presque naturelle. La mort de son fils Jacob a été pour lui un traumatisme définitif, qui a bouleversé ses relations avec sa famille. Son caractère de paria s’est creusé, malgré la présence attentive de sa très jolie femme.
Desplechin se garde bien d’apporter une explication. Il laisse seulement des indices, disséminés ici ou là. Avant qu’ils ne se détestent, Alice et Louis s’aimaient follement. Tous deux sont des êtres excessifs, qui vivent leurs passions avec une grande intensité. L’origine de leur brouille remonte à bien plus loin que la mort de Jacob. Sans doute à leur enfance ou à leur adolescence. Et un jour, alors que Louis reçoit un prix littéraire, sa sœur lui déclare, en riant à gorge déployée, qu’elle le hait.
Desplechin nous montre des scènes qui pourraient être des rêves ou des fantasmes. Ainsi quand Louis, sautant de son balcon, s’envole dans les airs et atterrit à l’hôpital dans le lit de sa mère. Dès lors, on ne sait plus très bien si ce qui arrive est réel ou bien une hallucination, d’autant plus que Louis consomme de l’opium. Tout ce flou est ce qui d’ailleurs permet au film d’acquérir une dimension psychanalytique assez évidente. Dès lors, il n’y aurait plus qu’à décrypter les sentiments grâce aux livres de Jacques Lacan, par exemple. Les références à la culture juive, dont Desplechin parsème son film, et dont il est un grand admirateur, vont peut-être dans ce sens.
Un des plus beaux passages de Frère et Sœur nous présente Louis accompagnant son meilleur ami, un psychiatre juif (joué par Patrick Timsit), à la synagogue pour la fête de Yom Kippour. C’est, on s’en souvient, le jour d’expiation des péchés, et Louis est vivement intéressé par ce qu’il entend. Il demande à son ami de lui traduire les paroles hébraïques prononcées par le rabbin. Or, en dressant l’oreille à cette scène, j’ai cru reconnaître la phrase suivante, tirée du Lévitique : « Tu ne découvriras pas la nudité de ta sœur, qu’elle soit fille de ton père ou fille de ta mère, qu’elle soit élevée à la maison ou au dehors. » Louis a l’air extrêmement touché par ces mots, comme si, justement, c’était ce qu’il avait à se reprocher avec sa propre sœur. Et un peu plus loin dans le film, pour aller encore dans le même sens, je note que Louis dit à Alice, lorsqu’ils se seront réconciliés : « Je pense à toutes ces années pendant lesquelles tu m’as laissé t’aimer. » Et que conclure d’une des dernières scènes, au cours de laquelle Louis et Alice se retrouvent nus dans le même lit ? Le message me semble clair, l’inceste est pointé du doigt ‒ sans nécessairement que cela soit très conscient chez Desplechin. Son film lui a peut-être échappé, en définitive.
Tout s’apaise, finalement. L’épilogue de Frère et Sœur est empreint d’espoir. Alice part se ressourcer en Afrique noire, et Louis reprend son travail de professeur à l’université. On le voit devant ses élèves, leur lisant un poème. Ce seront les ultimes paroles de Louis, dans le film de Desplechin. Il faut donc leur accorder l’importance qu’elles méritent. Je me suis renseigné. Il s’agit d’un extrait d’une œuvre du poète américain Peter Gizzi, né en 1959 dans le Michigan, lui-même professeur dans une université. Le titre en est : « Quelques valeurs du paysage et du temps » (en anglais Some values of lanscape and weather). Peter Gizzi y décrit tout ce qu’une génération a pu traverser et ressentir face à l’histoire, guerres comprises. C’est une poésie lyrique, très subjective, que je ne connaissais pas, et j’ai été frappé par la beauté des images. Au spectateur du film de Desplechin, maintenant, de réfléchir et de comprendre les rapports entre ce qu’il nous a raconté et ces quelques vers, que je vous cite à présent :
Où étions-nous
sur le ponton en train de fumer
après un jour au lit. Quelques orangés
et du velours bleu esquissent la forme des toits.
Ce n’est pas la première fois que ce sifflement nous arrête,
le train au crépuscule. Nous rappelant oum-pahs les appels
des cuivres bosselés autrefois sur la route :
de l’étoffe, des cheveux, et une corde pour nous guider.
Emmène-moi. Pour ne pas nier ces années
j’ai besoin de rester dans mon ornière
assez longtemps pour faire une embardée en dehors
de cette collision de particules qui gêne ma vue.
Je travaille d’arrache-pied pour renvoyer
d’autres palans de sauvetage ‒ quelque chose
de particulier au bleu a commencé
à remonter de la profondeur et à faire son schtick.
Et tombant dans la nuit, bien sûr
j’ai besoin de toi, mais cela dit
toutes les cordes lancées par-dessus bord
ne me trouveraient pas, comme le soleil autrefois
goutte à goutte dans le monde punk des sous-sols.
Le poème de Peter Gizzi, d’où est extrait ce passage, figure dans la brochure intitulée Revival, traduction de Pascal Poyet, éditions cipM/Spectres Familiers, collection « Le Refuge », 2003. Pour tout renseignement : CIPM Centre de la Vieille Charité 2, rue de la Charité 13002 Marseille (04 91 91 26 45). Il est possible de commander la brochure pour 10 €.
06:26 Publié dans Film | Tags : arnaud desplechin, "frère et soeur", james joyce, haine, rêves, fantasmes, psychanalyse, pensée juive, inceste, peter gizzi, poésie | Lien permanent | Commentaires (0)
09/05/2019
Deux conseils de lecture
1° Thierry Laget, Proust, prix Goncourt. Une émeute littéraire. Éd. Gallimard, 19,50 €. Le mercredi 10 décembre 1919, Marcel Proust reçoit le prix Goncourt pour À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Dans cet essai d'histoire littéraire, Thierry Laget nous conte par le menu cet événement qui eut son importance dans la vie de Proust. Il est deux heures de l'après-midi à peu près, et l'auteur d'À la recherche du temps perdu dort encore. Sa gouvernante Céleste décide de le réveiller. "Monsieur, lui dit-elle, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer, qui va sûrement vous faire plaisir... Vous avez le prix Goncourt !" Thierry Laget reproduit la réaction très courte de Proust : "Ah !" Et il commente : "Le laconisme de Proust trahit son émotion ; lui, d'habitude si éloquent, ne parvient à articuler à cet instant-là que la phrase la plus brève de sa vie." Thierry Laget est un spécialiste réputé de Proust. Il avait déjà travaillé sur ce thème du Goncourt de Proust pour sa thèse. Il y revient aujourd'hui, en un livre délicieux, écrit avec finesse, et qui fera rentrer le lecteur au plus près de l'univers proustien. Un régal pour les amateurs.
2° Aragon, La Grande Gaîté suivi de Tout ne finit pas par des chansons. Éd. Gallimard, coll. "Poésie/Gallimard". La Grande Gaîté est un recueil de poèmes d'Aragon, publié chez Gallimard en 1929. La tonalité de ces textes est dépressive, comme le confirme dans sa préface Marie-Thérèse Eychart. Nous sommes peu avant la rencontre avec Elsa. Aragon vit avec Nancy Cunard, entre Paris et Venise. Leur relation tient plutôt de l'enfer, et Aragon fait une tentative de suicide. Les poèmes de La Grande Gaîté reflètent cet état d'esprit sinistre. Aragon s'en est expliqué plus tard, en 1973, dans ce parfait petit texte en prose intitulé Tout ne finit pas par des chansons. Cet opuscule poétique d'Aragon revêt donc une importance cruciale, pour ceux qui s'intéressent à son cheminement créatif. Jamais Aragon ne reviendra à des œuvres aussi désespérées, concises dans leur amertume, violentes dans leur désenchantement. La beauté formelle, elle, était toujours là, sous le soleil noir de la mélancolie.
08:12 Publié dans Livre | Tags : proust, prix goncourt, aragon, la grande gaîté, dépression, suicide, nancy cunard, soleil noir, poésie, thierry laget | Lien permanent | Commentaires (0)
23/07/2016
Giorgio Caproni ou la fin de l'idylle
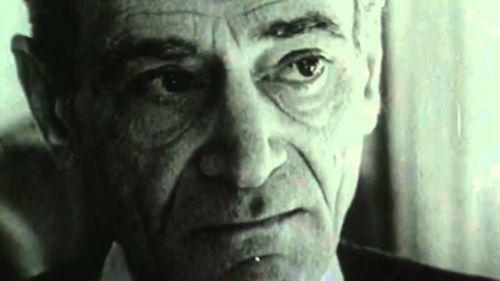
Giogio Caproni (1912-1990) est l'un des plus grands poètes italiens du XXe siècle, et pourtant il aura fallu attendre jusqu'à aujourd'hui pour avoir une traduction complète de ses œuvres en français. Je me souviens, il y a quelques années, de la revue Po&sie qui proposait à ses lecteurs quelques extraits du Passage d'Énée, avec une traduction du fameux poème "Les bicyclettes". C'était certes suffisant pour attirer l'attention sur un auteur vraiment unique, qu'on n'oubliait pas. Le volume qui est sorti aux éditions Galaade, il y a déjà un petit moment, et qui regroupe l'œuvre poétique complète de Caproni dans notre langue, est donc un événement des plus importants. Il donne la possibilité d'avoir enfin une vue d'ensemble de ce travail poétique, commencé en 1932, et qui a subi de belles métamorphoses jusqu'aux années 1980. J'ai pris un grand plaisir à lire cet épais volume, et à me plonger dans cet univers plein de surprises, avec peut-être une thématique souterraine qu'on perçoit assez rapidement, et qui serait celle d'un "désespoir tranquille", comme l'écrit quelque part Caproni. En effet, face à une modernité assez terrible (une sorte de nihilisme propre au XXe siècle), le poète a eu peu de marge de manœuvre. Il est toujours "Un homme seul, / reclus dans sa chambre". La nuit est son lot : "Que voulez-vous que je demande. / Laissez-moi dans ma nuit. / Rien que cela. Que je voie." Caproni a très bien perçu l'angoisse du vide, qui baignait une société en plein bouleversement : "Vide / du blé qui un jour avait atteint / (dans le soleil) la hauteur du cœur." Parfois moraliste, souvent métaphysicien, Caproni sait montrer la distorsion nouvelle qui s'impose dans la pensée, sous l'éclairage du Nietzsche de la mort de Dieu : "Dieu n'existe / qu'à l'instant où tu le tues." On a dit souvent que Caproni était le poète de l'oxymore. Cela est vrai. Il fallait cette ambiguïté fondamentale pour faire apparaître ce qui restait d'être dans le monde, tâche à laquelle la poésie s'attèle traditionnellement, même si cette ambition est vouée désormais à un quasi-échec : "Je suis revenu, écrit Caproni, là où je n'ai jamais été." Comme chez tout grand auteur, on sent chez lui ce désir de "franchir l'humain", comme le disait Dante, mouvement inlassable de la parole, de la voix poétique. Ce travail, alors, ouvre désespérément un espace littéraire qui nous laisse figés devant la chute vertigineuse qu'il nous propose, – tout en ne cessant de nous conserver, marque distinctive de Caproni, dans une douceur particulière qui rend cette chute plus humaine.
Giorgio Caproni, L'Œuvre poétique. Traduit de l'italien par Jean-Yves Masson, Isabelle Lavergne, Bernard Simeone et Philippe Renard. Édition établie et présentée par Isabelle Lavergne et Jean-Yves Masson. Éd. Galaade. 45 €.
11:17 Publié dans Poésie | Tags : giogio caproni, poésie, poésie italienne, le passage d'énée, désespoir, modernité, nihilisme, la nuit, le vide, la mort de dieu, nietzsche, oxymore, ambiguïté, chute | Lien permanent | Commentaires (2)
26/05/2016
En feuilletant Jacques Roubaud

Je ne suis pas particulièrement spécialiste de l'Oulipo, même si j'ai une grande admiration pour Queneau ou Georges Perec. Je crois que leur grandeur réside entre autres dans le fait qu'on peut les lire sans être trop conscient de la contrainte oulipienne qui est à la source de leur inspiration. Je viens d'en faire l'expérience, à nouveau, avec un autre grand représentant de l'Oulipo, le poète Jacques Roubaud. Il a publié voici quelque temps, dans la collection "Poésie/Gallimard", une "Anthologie personnelle", sous le titre de Je suis un crabe ponctuel. On y retrouve, choisis par lui, des extraits de son œuvre poétique depuis 1967 jusqu'à 2014. Cela donne un petit livre extrêmement agréable à feuilleter, qui reflète une grande diversité de thèmes. La poésie un peu obscure, ésotérique, du tout début, évolue ensuite vers la clarté, et le jeu avec les mots et les formes (Jacques Roubaud est un passionné du sonnet). J'ai eu beau sans doute ne pas repérer d'éventuelles règles internes, propres à l'Oulipo, je me suis malgré cela laissé porter par ces poèmes très vivants, souvent drôles, qui se lisent et se relisent avec une vraie délectation ; qui sont le contraire de la tristesse, même si parfois, au détour d'une page, la gravité apparaît comme dans un haïku japonais : "Or, comme la lune qui, s'inclinant vers l'ouest, se rapproche de l'arête des collines qui vont la cacher, mes jours sont en déclin. A la veille d'entrer dans les ténèbres de la mort, pourquoi me préoccuper des choses ?" (Autobiographie, chapitre dix)
Jacques Roubaud, Je suis un crabe ponctuel. Anthologie personnelle 1967-2014. Gallimard, coll. "Poésie/Gallimard"
14:55 Publié dans Poésie | Tags : jacques roubaud, oulipo, queneau, georges perec, anthologie, sonnet, poésie, haïku | Lien permanent | Commentaires (0)
21/09/2015
Ingeborg Bachmannn, la chute dans le temps

L'écrivain autrichien Thomas Bernhard n'a à ma connaissance jamais parlé de Paul Celan, et de sa poésie fulgurante. Bernhard s'intéressait pourtant bien à ce genre littéraire, qu'il a lui-même illustré dans sa jeunesse, avant de ne devenir exclusivement que romancier. En revanche, concernant sa compatriote exilée à Rome, Ingeborg Bachmann, les allusions de Bernhard sont multiples et louangeuses. Parlant d'elle, il écrit dans L'Imitateur, peu après le décès de Bachmann à Rome en 1973, qu'elle fut "la poétesse la plus intelligente et la plus importante que notre pays ait produite au cours de ce siècle". Il ajoute aussi qu'il a "partagé beaucoup de ses vues philosophiques". À tel point sans doute qu'il en a fait l'un des personnages principaux (celui de Maria) dans son dernier et fabuleux roman, Extinction (Gallimard, 1990), roman qui se déroule entre Rome et l'Autriche, cette "heureuse Autriche" qui n'eut de cesse d'exclure et de persécuter ses plus beaux esprits.
C'est une bonne surprise de voir la publication ces jours-ci d'une vaste anthologie bilingue des œuvres poétiques d'Ingeborg Bachmann, dans une édition de Françoise Rétif. Un large éventail nous est ainsi proposé, des œuvres de jeunesse en passant par les deux recueils édités du vivant de l'auteur, Le Temps en sursis et Invocation de la grande ourse, jusqu'à des poèmes inédits datant des années 1962-1967. On perçoit l'évolution du style poétique de Bachmann, ses contradictions internes qui rendent son cheminement particulièrement vivant. Effarée par un monde livré à la violence, l'auteur de Malina, son unique roman, n'a pas renoncé à l'idéal, du moins au début, et à espérer : "Ne pas céder à la résignation, comme l'écrit Françoise Rétif dans l'introduction, c'est combattre le pouvoir de la nuit et de l'ombre pour affirmer celui du soleil, de la lumière et de l'amour...". Néanmoins, comme le montrent ses derniers poèmes, dans lesquels elle se rapproche par la forme et le fond de Paul Celan, un "délitement", comme le remarque Françoise Rétif, se manifeste, dont on a du mal peut-être à cerner tout de suite la cause exacte, mais qu'on peut bien imaginer, néanmoins, avec l'aide, là encore, de l'indispensable Thomas Bernhard : "Elle avait, comme moi, trouvé très tôt déjà l'entrée de l'enfer, et elle était entrée dans cet enfer au risque de s'y perdre prématurément."
Il y a incontestablement un destin commun à toute cette génération d'écrivains de langue allemande nés grosso modo au milieu de la dernière guerre ; ils ne durent compter que sur eux-mêmes pour lutter contre l'emprise d'une langue maudite reçue en héritage, souillée par ce qu'en avaient fait les nazis. Il ne s'agissait, ni plus ni moins, que de la recréer. Tâche radicale, comme un enjeu évident de toute poésie, mais que la suite de l'Histoire, cet après-guerre perdu dans la reconstruction économique, allait malheureusement mettre en décalage. C'est pourquoi, aujourd'hui, sans aucun doute, l'œuvre d'une Ingeborg Bachmann nous parle avec autant de précision.
Ingeborg Bachmann, Toute personne qui tombe a des ailes. Poèmes 1942-1967. Édition, introduction et traduction de l'allemand (Autriche) par Françoise Rétif. Bilingue. Poésie/Gallimard, 13,50 €.
12:55 Publié dans Poésie | Tags : ingeborg bachmann, poésie, toute personne qui tombe a des ailes, paul celan, thomas bernhard, l'imitateur, extinction, rome, autriche, le temps en sursis, invocation de la grande ourse, malina, françoise rétif | Lien permanent | Commentaires (0)
11/04/2015
Leopardi, un effondrement

En me rendant au cinéma pour assister à une séance de Leopardi, le nouveau film de Mario Martone, je me demandais déjà comment y serait traitée la poésie. Illustrer la vie de Leopardi en images reste a priori une gageure, car il faut pour cela aller puiser son propos dans ce qu'un être humain, qui plus est un poète de part en part, a de plus secret. À voir ce film, on se dit que le pari n'a pas été vraiment gagné. Tout le début, qui n'en finit pas, se déroule dans la maison paternelle, où Leopardi reçoit certes une solide éducation, entouré des bibliothèques et du silence qui favorisent l'étude. Cet univers clos, cependant, lui devient vite une prison, avant qu'il ne réussisse à s'en échapper. Commence alors une errance de Florence à Rome, de Rome à Naples, que le film de Martone nous montre dans ses mille détails quotidiens, autour d'un Leopardi de plus en plus malade, infirme, sans le sou, et surtout plus ou moins rejeté par la société de son temps. Les lettrés italiens, qu'il côtoie, trouvent sa poésie trop pessimiste, trop sombre. Le réalisateur reconstitue de façon très intéressante tout cet environnement, mais, et c'est le principal reproche que je ferai à son film, ne nous fait jamais entrer, ou quasiment, dans la poésie même de Leopardi. Quelques extraits, bien sûr, sont lus en voix "off", mais c'est tout. Sa philosophie elle-même, si importante pour comprendre l'homme, n'est évoquée que très indirectement. Il nous faut par contre subir longuement le spectacle de la lente désagrégation de son existence. C'est sans nul doute, je dois l'admettre, un numéro d'acteur assez exceptionnel (Elio Germano réussit à incarner un Leopardi plus vrai que l'original). Mais sur ce qui faisait l'essentiel de sa personnalité, son génie unique de poète, sa pensée profonde, le spectateur restera complètement sur sa faim. Malgré quelques scènes avant-gardistes, le cinéma de Mario Martone semble bien timide, et en réalité ne va jamais au-delà des limites traditionnelles imparties aux biopics modernes. Il en aurait eu incontestablement les moyens, et peut-être l'envie, mais il s'est arrêté avant de franchir le pas, — avant d'accomplir peut-être un exploit qui aurait tiré son film vers autre chose. C'eût été l'occasion rêvée ; mais le cinéma contemporain, on ne le sait que trop, paralyse les metteurs en scène un peu créatifs. Ceux-ci sont, de manière systématique, coupés dans leur élan par des producteurs et des distributeurs qui n'ont en vue que la réussite commerciale d'une œuvre. Le pire, avec ce Leopardi, est donc, comme je le disais, qu'en chemin on a oublié la poésie, c'est-à-dire l'art. Le petit pantin bossu et désarticulé, que nous voyons s'agiter en vain sur l'estrade deux heures de temps, ne nous mènera pas au seuil de sa propre création littéraire. — Pour cela, il faudra nous replonger dans le vaste corpus que constituent ses œuvres complètes, qui seules gardent authentiquement, même dans leur traduction française, l'émotion poétique originelle de celui qui est considéré désormais, après Dante, comme le plus grand poète que l'Italie ait donné au monde.
Illustration : photographie de Leopardi
12:00 Publié dans Film | Tags : leopardi, leopardi il giovane favoloso, mario martone, elio germano, poésie, silence, florence, rome, naples, maladie, pessimisme, effondrement, biopic, dante, italie | Lien permanent | Commentaires (0)
26/06/2014
La poésie, Jean-Luc Godard !

C'est Aragon, toujours perspicace, qui posait la bonne question, autrefois, dans un article fameux de 1965 écrit à l'occasion de la sortie de Pierrot le fou : "Qu'est-ce que l'art, Jean-Luc Godard ?" Le nouveau film du Dostoïevski de Lausanne, Adieu au langage, est véritablement une synthèse de tout son travail effectué jusqu'à ces dernières années. Un travail sur la fiction, d'abord ; et ensuite, plus fondamentalement peut-être, un travail sur la pensée. La vaste série des Histoire(s) du cinéma le montrait bien, étape essentielle d'un parcours dont rien ne vint affaiblir la rigueur. Film socialisme, sa précédente œuvre, apparaissait encore comme un ensemble hybride, certes extrêmement riche et passionnant, mais décevant au plan de la forme. Ce coup-ci, avec Adieu au langage, nous y sommes : chaque élément a trouvé sa place dans un édifice artistique incomparable. Godard est avant tout poète, comme Aragon l'avait pressenti de manière évidente. Cette poésie aujourd'hui se déchaîne avec une ampleur kaléidoscopique, seulement disciplinée par des références nombreuses que Godard va chercher chez les grands écrivains (dont Maurice Blanchot) ou les philosophes. L'ombre tutélaire de Soljenitsyne inspire au cinéaste de présenter son film comme un "essai d'investigation littéraire". Mais il est certes beaucoup plus que cela. Difficile de définir à vrai dire ce projet, sinon en disant que Godard suit les traces de Lautréamont. Un critère existe, cependant, qui me sert personnellement à qualifier les chefs-d'œuvre : je note que je relirai volontiers tel livre, que je reverrai volontiers tel film. Eh bien ! je vais profiter de ce qu'Adieu au langage est toujours à l'affiche pour aller le revoir, expérience stimulante.
12:29 Publié dans Film | Tags : jean-luc godard, dostoïevski, adieu au langage, aragon, pierrot le fou, poésie, art, fiction, histoire(s) du cinéma, film socialisme, maurice blanchot, soljenitsyne, essai d'investigation littéraire, lautréamont | Lien permanent | Commentaires (0)
27/11/2013
Quelque chose échappe
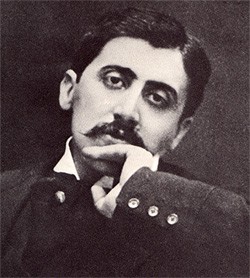
La littérature, contrairement à la philosophie, n'a pas la prétention de tout dire. Elle affirmerait même volontiers que quelque chose lui échappe. Quand je lis une fiction, un poème, je suis en quête de ce qui est au-delà de l'œuvre, qui l'excède obscurément. Deleuze s'est un peu fourvoyé, dans son livre sur Proust, en tentant d'expliquer schématiquement la théorie du temps dans La Recherche. Bien loin de nous éclairer, il nous fait regretter l'élaboration parfois impalpable en jeu dans le roman. Au fond, ce qu'on désire avant tout, c'est ressentir : telle est l'expérience littéraire qui absorbe et fascine le lecteur, et non la formule rationnelle, dénuée de poésie et de tout sentiment, que voudrait nous transmettre une prétendue science. Le flou artistique, sorte de spirale infinie, est plus riche qu'un trait trop abrupt.
23:51 Publié dans Livre | Tags : littérature, philosophie, proust, deleuze, flou artistique, poésie, roman | Lien permanent | Commentaires (0)
