02/01/2023
Actualité du philosophe Jacques Derrida
Derrida, l’animal comme prochain
La question de l’animal hante la philosophie moderne, en passant par Descartes jusqu’à Heidegger (« l’animal est pauvre en monde », a-t-il écrit). En France, beaucoup de philosophes se sont interrogés récemment sur le statut de l’animal dans la Création. Jacques Derrida est certainement l’un d’eux, attentif comme on sait à l’œuvre de Heidegger, et prônant une déconstruction qui s’attache aussi à montrer que l’animal serait ouvert à l’éthique.
C’est ainsi que la philosophe Orietta Ombrosi reprend toute cette thématique dans son nouveau livre, Le Bestiaire philosophique de Jacques Derrida. Cette spécialiste de la pensée d’Emmanuel Levinas a suivi les séminaires de Derrida à l’EHESS, notamment celui intitulé « La bête et le souverain ». Elle a donc eu l’occasion de constater l’intérêt de Derrida pour cette question, riche d’implications essentielles. Elle note de manière significative que, déjà, pour l’être humain, « l’altérité de l’autre […] va de pair avec la question de l’animal ». Orietta Ombrosi se propose de relire certains textes de Derrida, comme le célèbre L’Animal que donc je suis (2006), de les commenter et de les discuter, en particulier en les confrontant à la pensée d’Emmanuel Levinas. Son livre, qui ne recule pas devant les digressions, se veut une méditation patiente plus qu’une synthèse définitive, sur une éventuelle métaphysique de l’animal.
Le détour par les concepts de Derrida, comme sa critique du logocentrisme remettant en question la primauté de l’homme occidental, permet d’examiner une valeur spécifique du règne animal. Orietta Ombrosi a alors recours au Levinas de Difficile liberté pour se demander si l’animal peut acquérir la dimension morale qui ferait de lui un « autre », comme si la bête, écrit-elle, « conservait une trace de la transcendance ». Pour Levinas et Derrida, la réponse est positive, même si, pour le premier, l’animal ne devient cependant jamais un « sujet éthique ». On voit que la pensée de Derrida n’hésite pas à aller très loin. Orietta Ombrosi cite un passage tiré de L’Animal que donc je suis, dans lequel Derrida précise : « Il s’agit aussi de se demander si ce qui s’appelle l’homme a le droit d’attribuer en toute rigueur à l’homme, de s’attribuer, donc, ce qu’il refuse à l’animal, et s’il n’en a jamais le concept pur, rigoureux, indivisible, en tant que tel. »
L’idée centrale de cet essai d’Orietta Ombrosi est bien là, au-delà du refus catégorique de toute souffrance, dans « la promesse elle-même, écrit la philosophe, celle faite à Abraham, celle d’un universalisme des singularités et des différences certes, mais aussi celle de la fin de l’effusion de sang, y compris le sang de toutes les créatures ». Orietta Ombrosi, forte de son « propos animaliste-judaïsant », s’autorise parfois quelques réserves avec ce que Derrida écrit, mais pas ici. Elle le note de manière très claire : Derrida, écrit-elle, « sacrifie, dans son écriture même, le sacrifice ».
Au fil de sa réflexion, Orietta Ombrosi passe en revue les différentes espèces animales dont Derrida a parlé dans ses livres ‒ mais aussi celles dont il n’a pas parlé, comme l’ânesse de Balaam, par exemple. Elle reprend, à partir des textes de Derrida, la méthode herméneutique qui, nous le savons, lui était chère. On sait que Derrida aimait souvent s’appuyer sur des œuvres littéraires, pour les commenter et développer ses théories. C’est l’un des traits du judaïsme, qui aime lire et relire à l’infini les versets des Saintes Écritures, tradition dont Derrida était évidemment proche. Cela nous vaut, à travers le double regard de Derrida et d’Orietta Ombrosi, de très beaux chapitres autour de pages littéraires immortelles, comme le commentaire consacré par Derrida au poème de Paul Valéry, « Ébauche d’un serpent ».
Orietta Ombrosi, dans ce copieux et passionnant Bestiaire philosophique de Jacques Derrida, montre que la pensée du philosophe a aujourd’hui conservé sa pertinence, et qu’elle n’était pas un simple effet de mode. L’auteur de L’Écriture et la Différence est parfois critiqué par certains, pour ses livres jugés trop difficiles ou obscurs... Mais s’arrêter là serait oublier que toute bonne philosophie, comme le disait Rousseau, mérite des efforts. Et le livre d’Orietta Ombrosi, dans ses passages les plus convaincants, nous prouve que de tels efforts sont souvent récompensés, avec un Jacques Derrida.
Orietta Ombrosi, Le Bestiaire philosophique de Jacques Derrida. Préface de Corinne Pelluchon. Éd. Puf, 24 €.
À signaler la réédition du livre de Benoît Peeters, Jacques Derrida. Éd. Flammarion, collection « Grandes biographies », 28 €.
À noter également la parution aux éditions du Seuil, dans la collection « Bibliothèque Derrida », d’un nouvel inédit du philosophe, Hospitalité, volume II, Séminaire 1996-1997, 24 €.
08:51 Publié dans Philosophie | Tags : derrida, orietta ombrosi, descartes, heidegger, emmanuel levinas, philosophie, paul valéry, rousseau | Lien permanent | Commentaires (0)
22/06/2016
Montaigne anthropologue

Claude Lévi-Strauss se reconnaissait deux références littéraires majeures, sur lesquelles il revint à plusieurs reprises au cours de son œuvre : Montaigne et Rousseau. L'anthropologie structurale doit beaucoup à ces deux grands auteurs et à la manière dont Lévi-Strauss a su les lire. Tristes tropiques, déjà, était un livre marqué par l'influence de Rousseau, véritablement fondatrice. Quant à Montaigne, il n'est que de citer les quelques pages décisives d'Histoire de lynx qui lui sont consacrées par Lévi-Strauss au chapitre XVIII, sous le titre de "En relisant Montaigne". Cette relecture d'un Montaigne anthropologue montrait avec acuité toute la modernité considérable de l'auteur des Essais. Une récente publication des éditions EHESS vient apporter de nouveau la preuve de cette importance de Montaigne pour Lévi-Strauss. Il s'agit de deux conférences inédites, l'une de 1937 et l'autre de 1992, qui tournent autour des Essais. À vrai dire, c'est surtout dans la deuxième que Lévi-Strauss étudie minutieusement le texte de Montaigne, et compare ce dernier à d'autres auteurs de l'époque qui ont relaté la découverte du Nouveau Monde, notamment Jean de Lery. La conférence aborde essentiellement le chapitre des Essais "Des cannibales" (I, XXXI), qui est également mis en relation avec d'autres passages significatifs. Retenons surtout la conclusion de cette belle démonstration qu'effectue ici Lévi-Strauss : "Et alors, si la première orientation de sa pensée [la pensée de Montaigne] conduit à la théorie du bon sauvage, si la deuxième orientation qui serait celle de construire à partir de zéro une société rationnelle, conduit au Contrat social, alors la troisième conduit au relativisme culturel intégral, et nous retrouvons, évidemment, les trois cultures, les trois manières d'envisager les problèmes dans les doctrines de l'ethnologie contemporaine." Il s'agit donc de bien discerner combien l'œuvre de Montaigne nous parle aujourd'hui. Lévi-Strauss a indiscutablement éclairé ce lien que nous pouvons entretenir avec un classique, et ceci parce que, sans doute, l'auteur de La Pensée sauvage est lui-même devenu un classique, au fil d'une anthropologie structurale édifiée patiemment pour rendre compte de notre univers complexe et infini.
Claude Lévi-Strauss, De Montaigne à Montaigne. Édition établie et présentée par Emmanuel Désveaux. Éd. EHESS, 8 €.
15:44 Publié dans Anthropologie | Tags : claude lévi-strauss, montaigne, rousseau, de montaigne à montaigne, tristes tropiques, anthropologie, les essais, jean de lery, nouveau monde, la pensée sauvage | Lien permanent | Commentaires (0)
07/02/2015
Forqueray sous les doigts de Gustav Leonhardt

La revue Diapason a ce mois-ci l'excellente idée de nous offrir le dernier enregistrement du claveciniste Gustav Leonhardt, disparu en 2012, qu'il avait consacré à Forqueray. Cet album était paru en 2005, mais de manière confidentielle chez EMR, label russe très mal distribué. Rares étaient les amateurs qui avaient pu se le procurer. Leonhardt y jouait un instrument Hemsch de 1751, clavecin exceptionnel de facture française, qui se trouve actuellement en Belgique, au château de Flawinne. Le résultat est somptueux, et a produit sur moi la même révélation que lorsque j'avais entendu pour la première fois le même Leonhardt dans les sonates de Scarlatti.
Il faut savoir qu'il y eut deux Forqueray, le père (Antoine, 1671-1745) et le fils (Jean-Baptiste, 1699-1782). Les pièces que nous écoutons là furent écrites par le père pour la viole de gambe. Les transcriptions pour le clavecin effectuées par le fils leur permirent de trouver un public d'amateurs enthousiastes, malgré leur relative difficulté. Forqueray le père, à la viole, avait la réputation de "jouer comme un Diable", allusion à sa redoutable virtuosité.
A travers ces délicats morceaux de musique, c'est tout un monde qui réapparaît. Ce temps était béni pour les arts — Antoine Forqueray fut nommé dès 1689 "Ordinaire de la Musique de la Chambre du Roi". C'est peut-être Rousseau qui, dans un passage de La Nouvelle Héloïse, exprime le mieux cette douceur, ces instants de poésie et de sensibilité qui ne reviendront jamais : "Tu chantais avec assez de négligence ; je n'en faisais pas de même ; et, comme j'avais une main appuyée sur le clavecin, au moment le plus pathétique et où j'étais moi-même émue, il appliqua sur cette main un baiser que je sentis sur mon cœur."
Diapason n° 632, février 2015 (7,50 €). Le CD est vendu à l'intérieur de la revue.
Illustration : Jean-Baptiste Forqueray
11:52 Publié dans Musique | Tags : antoine forqueray, jean-baptiste forqueray, gustav leonhardt, clavecin, revue diapason, clavecin hemsch, château de flawinne, sonates de scarlatti, amateurs, virtuosité, ordinaire de la musique de la chambre du roi, rousseau, la nouvelle héloïse | Lien permanent | Commentaires (0)
23/08/2014
Le roman par lettres

Il y a dans le roman par lettres une forme de pluralité extrême, surtout lorsque c'est aussi réussi, selon moi, que dans une œuvre comme La Nouvelle Héloïse de Rousseau. Derrida faisait remarquer dans son Séminaire qu'une narration telle que Robinson Crusoé exprimait la faculté d'appropriation du sujet : Robinson veut d'abord se rendre maître de l'île sur laquelle il a échoué, puis, en relatant ses aventures par écrit, s'en rendre possesseur par l'imaginaire. Le point de vue est ici unifié, unique, sans contrepoint. A l'inverse, dans les romans par lettres, les perspectives se chevauchent, le sens n'est jamais donné une fois pour toutes. Les personnages sont comme expropriés d'eux-mêmes. C'est par exemple, dans La Nouvelle Héloïse, ce qui arrive lorsque la mère de Julie découvre la correspondance amoureuse de celle-ci. Les répercussions accidentelles de cet événement seront considérables pour les deux femmes, sans jamais pourtant être avérées à leurs yeux. Ces événements les dépassent. C'est aussi, très subtilement, inscrivant une temporalité et une mémoire dans la dramaturgie du roman, l'épisode où Julie cite à Saint-Preux le passage d'une de ses lettres plus anciennes (cf. 3ème partie, Lettre XVIII). Le récit de Rousseau joue sur la nostalgie du passé comme élément de décomposition. Le lecteur ressent cette impression d'éparpillement, d'altération dans la complexité des caractères. Nous savons que Robinson Crusoé va s'échapper de son île, mais dans La Nouvelle Héloïse nous ignorons tout du destin de Julie avant d'avoir lu la fin de l'histoire. Les multiples voix présentes dans le roman par lettres, quand le procédé du moins est poussé jusqu'au bout, c'est-à-dire orienté vers le réalisme, forment des constellations particulièrement modernes qui parlent à notre sensibilité de manière toujours plus inédite.
Illustration : gravure pour La Nouvelle Héloïse.
14:47 Publié dans Livre | Tags : rousseau, la nouvelle héloïse, pluralité, jacques derrida, séminaire, robinson crusoé, daniel defoe, île, aventures, imaginaire, roman par lettres, temporalité, mémoire, dramaturgie, roman, nostalgie, décomposition, altération, voix, réalisme, constellations | Lien permanent | Commentaires (0)
30/05/2014
Bashô et le bol du pèlerin
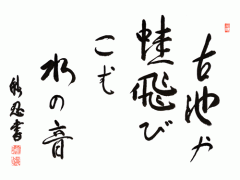
Je lis depuis quelques jours la nouvelle Pléiade des œuvres du poète Philippe Jaccottet. L'agencement de ce volume me semble particulièrement réussi : des poèmes, bien sûr, mais aussi des proses, et des Carnets (La Semaison) dans lesquels on se plongera avec délice. A condition peut-être d'aimer la nature, car il en est beaucoup question chez Jaccottet, disciple de Rousseau et de Bashô notamment. Dans un excellent avant-propos, José-Flore Tappy évoque du reste un texte du Japonais, qui a beaucoup marqué Jaccottet. Il s'agit de La Sente étroite du Bout-du-Monde, récit de voyage publié par la revue L'Ephémère en juin 1968. "Jaccottet trouve dans ce récit plein d'esprit et de mélancolie, fait de rencontres et de séparations successives, une image de ce que devrait être pour lui la poésie." Il y revient plus tard, dans une note de La Semaison, explorant cette affinité personnelle qui devait le marquer profondément : "L'absolue merveille de cette prose, de cette poésie, écrit Jaccottet, est qu'elle ne cesse de tisser autour de nous des réseaux dont les liens, toujours légers, semblent nous offrir la seule liberté authentique." Je ne m'étonne donc pas, en le relisant vers la fin du volume, de l'éblouissement d'authentique liberté que nous laisse un texte comme Le Bol du pèlerin. C'est à mon sens l'un des plus beaux livres qu'on ait jamais consacré à un peintre, en l'occurrence Giorgio Morandi. Jaccottet y déploie toutes ses ressources de poète et de prosateur pour nous faire pénétrer dans cet univers qui le touche si fort. Un univers minimaliste, intense, qu'il prenait soin, déjà, de mettre en relation avec celui des Japonais, dans une note essentielle de La Semaison. Jaccottet y écrivait par exemple (mais toute la note serait à citer) : "On pense aux moines-poètes du Japon à cause de la pauvreté humble, du bol blanc, ou de ce qui pourrait être un encrier." Il faut avoir tout ceci à l'esprit pour comprendre Jaccottet, sa rigueur, son éloignement géographique (il a choisi de vivre retiré à la campagne), sa méfiance même pour les sinécures professionnelles qui vous volent votre âme. Son travail poétique est constitué de cette exigence, avec les yeux grands ouverts sur cet enjeu (comme disait Soupault) dont trop peu d'écrivains ou de poètes gardent aujourd'hui le souci. Je crois qu'un récit comme L'Obscurité, qui figure aussi dans ce volume de la Pléiade, est emblématique de cette grandiose tradition.
Philippe Jaccottet, Œuvres. Préface de Fabio Pusterla. Edition établie par José-Flore Tappy, avec Hervé Ferrage, Doris Jakubec et Jean-Marc Sourdillon. Ed. Gallimard, "Bibliothèque de la Pléiade".
Calligraphie : haïku de Bashô.
12:32 Publié dans Livre | Tags : bashô, philippe jaccottet, poème, prose, bibliothèque de la pléiade, gallimard, la semaison, rousseau, japon, la sente étroite du bout-du-monde, récit de voyage, revue l'éphémère, le bol du pèlerin, giorgio morandi, minimalisme, moines-poètes, pauvreté, bol, encrier, l'obscurité, récit, tradition | Lien permanent | Commentaires (0)
13/04/2014
Le petit Marcellin
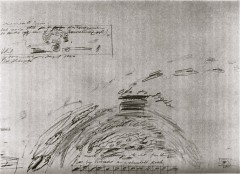
Dans La Nouvelle Héloïse, le dénouement tragique est provoqué par le fils de Julie. En tombant dans l'eau sous ses yeux (pour être sûr qu'elle le sauve ?), celui-ci devient la cause directe de la mort de sa mère. Certes, l'enfant ne l'a sans doute pas vraiment fait exprès, même si la psychanalyse nous dirait que quelque pulsion inconsciente, propre aux relations mère-fils, a pu se trouver à l'origine de l'accident. On peut aussi imaginer que, par la suite, la vie entière du petit garçon sera tourmentée par cet événement traumatisant, fondateur pour lui. Il se sentira éternellement coupable, et même se considérera quasiment comme le meurtrier de sa mère : je crois que, s'il avait écrit ce roman à notre époque, Rousseau aurait sans doute insisté sur cet aspect souterrain de l'âme enfantine, et décrit en détail les affres du petit Marcellin.
Illustration : Cy Twombly
06:13 Publié dans Livre | Tags : la nouvelle héloïse, rousseau, roman, julie, mère, relations mère-fils, mort, psychanalyse, pulsion inconsciente, traumatisme, culpabilité, meurtrier, âme enfantine, affres | Lien permanent | Commentaires (0)
